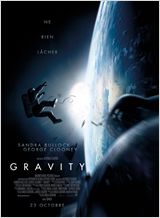 Après des monuments en tous genres traitant de la question du cosmos (2001 l’odyssée de l’espace, Alien ou, dans une moindre mesure, le mésestimé Sunshine de Danny Boyle), Alfonso Cuarón revient au cinéma après sept ans d’absence. Ni propos métaphysique sur l’évolution de l’existence, ni film de monstres ni fable d’action écologique, le cinéaste mexicain propose avec cette nouvelle excursion dans les studios hollywoodiens une expérience hors-normes qui tient autant du survival que de l’huis-clos. Cet huis-clos (inversé puisque les proportions d’espace et de vide créent paradoxalement l’angoisse, quand les intérieurs exigus des capsules évoquent irrémédiablement la sécurité et le confort) narre en 90 minutes la succession de causes à effets subie par une astronaute livrée à elle-même à la suite d’une pluie de débris. Il ne sert à rien ici de chercher un film d’écriture complexe, mais plutôt une attraction ultime, superbe, où le réalisme cinématographique existe avant par la conviction du spectateur en son engagement physique dans le film, à travers les effets rotatifs et d’apesanteur, de géométrie et de flottement, le tout en 3D.
Après des monuments en tous genres traitant de la question du cosmos (2001 l’odyssée de l’espace, Alien ou, dans une moindre mesure, le mésestimé Sunshine de Danny Boyle), Alfonso Cuarón revient au cinéma après sept ans d’absence. Ni propos métaphysique sur l’évolution de l’existence, ni film de monstres ni fable d’action écologique, le cinéaste mexicain propose avec cette nouvelle excursion dans les studios hollywoodiens une expérience hors-normes qui tient autant du survival que de l’huis-clos. Cet huis-clos (inversé puisque les proportions d’espace et de vide créent paradoxalement l’angoisse, quand les intérieurs exigus des capsules évoquent irrémédiablement la sécurité et le confort) narre en 90 minutes la succession de causes à effets subie par une astronaute livrée à elle-même à la suite d’une pluie de débris. Il ne sert à rien ici de chercher un film d’écriture complexe, mais plutôt une attraction ultime, superbe, où le réalisme cinématographique existe avant par la conviction du spectateur en son engagement physique dans le film, à travers les effets rotatifs et d’apesanteur, de géométrie et de flottement, le tout en 3D.
À partir d’une trame simple et plausible, Alfonso Cuarón déroule un récit en temps réel (même s’il n’en s’agit pas), accumulant les catastrophes mécaniques et psychiques en une métaphore assez subtile de l’existence morbide et de la solitude humaine. Le docteur Ryan Stone semble détachée, dans un flottement intérieur perpétuel (Sandra Bullock, dont on peut certainement applaudir les nuances de jeu lors d’un tournage dont le décor est résolument abstrait et vide, seule face à une machinerie de cinéma), figure de la mère endeuillée prise en étau dans un vide infini dont la magie visuelle ne promet pourtant aucune projection de l’enfant déchu, incarne aussi l’instinct de survie, l’idée du dépassement de soi face à la fin de toute chose. L’idée, simple et belle, d’offrir à son unique personnage le don d’être brisé par la vie et de retrouver un but dans le néant spatial ouvre le film vers toutes les portes métaphysiques, ce que Cuarón traite de manière efficace et sans chercher la surenchère. Hormis un beau clin d’oeil au foetus astral de Kubrick (qui prend ici une dimension bien à part), ces enjeux et questionnements métaphysiques ne servent, face à la grandeur écrasante et intimidante de l’espace, qu’à renforcer la faiblesse émotionnelle du spectateur dans son immersion à travers le superbe spectacle physique et organique que travaille le découpage en plans-séquences et en immenses plans d’ensemble. Le montage du film, dans ses associations géométriques fulgurantes, est évidemment l’outil pur du traité de l’espace et de la durée. Cuarón a compris la chose la plus simple qui soit et que le cinéma moderne hollywoodien a pour fonction habituelle de transfigurer à tout prix : plus un décor est grand, plus le montage doit le laisser transparaitre, autrement dit, ici l’infinité spatiale induit par la logique de la valeur de ses plans la distorsion du temps à travers toutes ses échelles de valeur, de son accélération jusqu’à son étiolement et sa perte. Ce qui équivaut alors à des configurations spatiales limpides et à une lisibilité totale. Entre les mouvements d’appareil en apesanteur (le lent plan-séquence d’ouverture, qui passe de l’immensité de l’univers à un très gros plan à l’intérieur du casque en renversant les visages, la terre, les distances et la perception de toute gravité communément admise) et le découpage brillant des scènes d’action – dans son plus beau degré de configuration épurée – , entre la langueur et la vitesse cosmique, les contrastes créent de purs moments de décrochage cinématographique. En ce sens, une séquence extraordinaire de drôlerie et d’étrangeté vient se nicher au sein du film, séquence de rêve qui renverse de façon inattendue la tonalité oppressante.
De superbes idées, en dehors de chaque fabuleuse scène d’action et de la tension générale, émergent du film ; des larmes en apesanteur venant se glisser contre l’objectif de la caméra, une explosion silencieuse qui finit par ressembler à un décor abstrait éclatant en particules, une arrivée finale sur terre qui ressemble à la découverte d’une planète inconnue – consacrant ainsi le réalisme orbital du film … Cuarón se dévoile en cinéaste exceptionnel dans la mesure où il évite les écueils de la fable et du récit métaphysique pour ne donner à voir qu’un film sur le triomphe de la technologie moderne en un matériau artistique à part ; un film où la prouesse permanente n’exclue ni les fulgurances, ni les retombées dramaturgiques, ni même la naîveté bienveillante comme source d’oxygène. Sensations que drapent doucement et sans insistance le mélodrame, le film de genre, le film d’angoisse, la tragédie existentielle née de l’être et de sa chair dans la contrainte nue de l’univers. Gravity, en convoquant cette gravité physique et les forces de gravité qui scandent nos existences – peut-on voir plus claire image de la mort? – se définit étrangement, sans accroches et loin des perceptions de la projection habituelle, comme un cinéma amniotique, flottant ardemment vers le retour à la vie.
Jean-Baptiste Doulcet
Gravity
Film américain, britannique de science-fiction de Alfonso Cuarón
Sortie : 23 octobre 2013
Durée : 01h30
