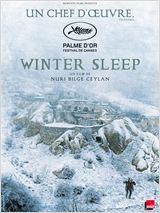 Habitué depuis ses premiers films à être invité et honoré dans les festivals de cinéma prestigieux (Cannes et Berlin), le turc Nuri Bilge Ceylan était donc le candidat prévisible, sinon parfait, pour recevoir cette année la Palme d’Or. D.’autant plus qu’il débarquait sur la Croisette avec un film monumental. Par sa durée, presque 200 minutes, mais également par ses influences : Tchekhov, dont quelques nouvelles l’ont directement inspiré, Bergman, Antonioni. Contenant en lui toutes les caractéristiques hautement affichées de chef d’oeuvre autoproclamé, le film, au lieu d’en faire un socle ou un tremplin pour mieux s’en affranchir et proposer une vision à la fois personnelle et transcendée, semble clouer au sol. Ou plus exactement enfermer au fond de cet hôtel troglodyte au coeur d’un hiver froid et neigeux, favorisant l’introspection et les longues conversations.
Habitué depuis ses premiers films à être invité et honoré dans les festivals de cinéma prestigieux (Cannes et Berlin), le turc Nuri Bilge Ceylan était donc le candidat prévisible, sinon parfait, pour recevoir cette année la Palme d’Or. D.’autant plus qu’il débarquait sur la Croisette avec un film monumental. Par sa durée, presque 200 minutes, mais également par ses influences : Tchekhov, dont quelques nouvelles l’ont directement inspiré, Bergman, Antonioni. Contenant en lui toutes les caractéristiques hautement affichées de chef d’oeuvre autoproclamé, le film, au lieu d’en faire un socle ou un tremplin pour mieux s’en affranchir et proposer une vision à la fois personnelle et transcendée, semble clouer au sol. Ou plus exactement enfermer au fond de cet hôtel troglodyte au coeur d’un hiver froid et neigeux, favorisant l’introspection et les longues conversations.
Des conversations, il va certes y en avoir entre les trois personnages principaux : l’hôtelier qui fut acteur – pardon, comédien – et écrit des articles sentencieux pour le journal local en ambitionnant d’établir l’histoire jamais écrite du théâtre de son pays, sa jeune et belle femme entièrement préoccupée de ses bonnes oeuvres auprès des pauvres et enfin sa soeur, venue d’Istanbul, oisive et aigrie par son divorce. Comme il l’est rappelé, l’oisiveté serait la mère de tous les vices ; toujours est-il qu’elle exacerbe ici les rancoeurs qui ne manqueront pas de s’exprimer au grand jour, encore qu’il conviendrait plutôt de parler de pénombre, celle du bureau de l’homme ou celle de la salle où se prennent repas et café. Le film explore en fait deux terrains différents et complémentaires : d’un côté, la domination sociale et l’humiliation (la scène inaugurale chez une famille de locataires), de l’autre la déréliction des rapports dans un couple, entre un frère et une soeur – le coeur de l’ensemble qui respire (ou suffoque ?) dans de longues scènes d’échanges à deux, plus rarement entre les trois. Outre qu’elles sont toutes captées à l’identique, dans une utilisation mécanique et donc lassante du champ contre-champ, elles servent aussi à déverser une logorrhée qu’on peine à trouver intellectuellement soutenue et excitante, une sorte de ramassis d’états d’âme de trois individus qu’on ne parviendra jamais à trouver sympathiques et, dès lors, envers lesquels éprouver un tant soit peu de compassion, trois nantis, héritiers et privilégiés, qui ressemblent beaucoup à cette catégorie dite †˜bobos’ des grandes villes européennes occidentales. Il y a tout le confort et la modernité (ordinateurs et internet) dans cet endroit reclus mais, dès qu’on le quitte, hélas trop peu, la misère et l’inégalité sociale sautent tragiquement aux yeux.
Formaliste revendiqué, le réalisateur des Climats a surtout déployé cet indéniable talent à saisir l’immensité et la désolation des paysages anatoliens, de nuit comme de jour. Winter Sleep est d’abord une succession de huis clos. Or, fussent-ils brillamment éclairés et décorés, ils n’en conservent pas moins leur atmosphère étouffante et pesante. Autrement dit, on ne retiendra pas dans la filmographie de Nuri Bilge Ceylan cet opus pour témoigner de ses aptitudes d’esthète. Il réemploie par ailleurs la structure d’Il était une fois en Anatolie, c’est-à -dire d’organiser une dernière partie épiphanique servant de conclusion et d’élargissement. Là où le retour en ville avec le resserrement sur le médecin et le juge dans la scène apocalyptique et décisive de l’autopsie magnifiait le long-métrage précédent, ici la volte-face de l’hôtelier et la démarche de sa jeune épouse laissent pantois. En effet, et c’est probablement là le problème majeur du film, après avoir montré la vilenie, l’arrogance, la turpitude – en clair, la misère du genre humain dans un esprit davantage dostoîevskien que tchekhovien – la rédemption aussi subite que naîve, la prise de conscience douloureuse et résolument positiviste n’en finissent pas d’interpeller.
Dans le long échange qui s’envenime entre le frère et la soeur, la place de l’artiste, la mission de l’intellectuel tiennent une place importante, comme si le réalisateur s’auto-analysait en produisant une mise en abyme dont on ne réussit pas à trancher si elle verse dans la lucidité ou se vautre dans la complaisance. Bizarrement, le personnage le plus important du film reste mutique : c’est celui d’un enfant qui regarde sans ciller le monde vicié des adultes qui l’entoure. Un monde hélas auquel il appartiendra tôt ou tard.
Patrick Braganti
Winter Sleep
Drame turc de Nuri Bilge Ceylan
Sortie : 6 août 2014
Durée : 03h16
