La sixième saison de Bosch (l’une des meilleures séries policières en cours, et l’une des plus ignorées), est peut-être la plus belle à date. Analyse d’une réussite…

Nous avions déjà signalé cette exception que constitue Bosch dans le domaine des séries télévisées « grand public » : voici un travail qui semble s’améliorer d’année en année, qui gagne à chaque saison du sens et de la profondeur, sans quasiment jamais sacrifier aux tristes rituels du genre que sont devenus les cliffhangers artificiels ou le délayage excessif du scénario pour remplir le programme du nombre d’épisodes pré-déterminé. La sixième saison de la série nous donne le sentiment d’avoir encore progressé en intérêt aussi bien qu’en crédibilité, ce qui vaut la peine d’être souligné.
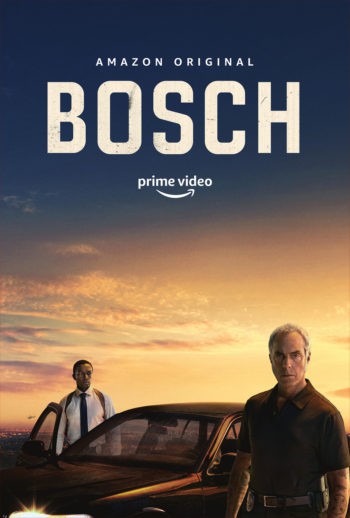 Le démarrage de la saison inquiète, les menaces terroristes, qui plus est nucléaires, sur Los Angeles nous rappelant l’époque des 24 heures et de Jack Bauer, ce qui n’est pas, avouons-le, très rassurant vu de 2020… Heureusement, très vite, le scénario nous dévoile les faux-semblants derrière cette histoire, et nous plonge dans une énigme à la « whodunnit » somme toute très classique (nous dirons plutôt éprouvée), dont la résolution est, surprise, surprise, assez rapide puisqu’à mi-saison, la partie « policière » est bouclée, laissant place à la partie « judiciaire ». Ce qui pourrait ailleurs constituer une maladresse de narration s’avère la force de cette saison, comme si cette histoire de césium dérobé avait été un McGuffin, et comme si l’important était AILLEURS…
Le démarrage de la saison inquiète, les menaces terroristes, qui plus est nucléaires, sur Los Angeles nous rappelant l’époque des 24 heures et de Jack Bauer, ce qui n’est pas, avouons-le, très rassurant vu de 2020… Heureusement, très vite, le scénario nous dévoile les faux-semblants derrière cette histoire, et nous plonge dans une énigme à la « whodunnit » somme toute très classique (nous dirons plutôt éprouvée), dont la résolution est, surprise, surprise, assez rapide puisqu’à mi-saison, la partie « policière » est bouclée, laissant place à la partie « judiciaire ». Ce qui pourrait ailleurs constituer une maladresse de narration s’avère la force de cette saison, comme si cette histoire de césium dérobé avait été un McGuffin, et comme si l’important était AILLEURS…
… Ailleurs, bien entendu, c’est dans toutes ces histoires parallèles qui se déploient, dans la continuité de la saison précédente : la rage des extrémistes « souverainistes » qui luttent contre le « trop d’état », la terrible criminalité au sein de la communauté haïtienne (délicieux – et incompréhensibles – dialogues en créole !) qui renvoie aux jours tragiques du totalitarisme sur l’île, la poursuite personnelle par Harry d’un cold case auquel il est émotionnellement attaché, la gestion opportuniste de la situation des SDFs à Los Angeles, la campagne aux élections municipales du Chef de la Police, l’utilisation d’une plainte de harcèlement sexuel pour un règlement de comptes entre collègues, les doutes d’une jeune femme idéaliste mais déterminée (la fille de Harry, désormais totalement incarnée par la toujours passionnante Madison Lintz, que l’on a aimé voir grandir, saison après saison) quant à son avenir professionnel pour servir le mieux possible la société,…
Une fois encore, la prolifération de enquêtes, de situations personnelles, et l’étroite imbrication entre vie professionnelle et vie intime de tous les protagonistes, ainsi que – comme dans les beaux romans de Michael Connelly – l’importance du TRAVAIL dans la résolution des cas sur lesquels bûchent les détectives, tout cela confère un sentiment de véracité aux situations, mais aussi d’une profonde humanité : des plus paumés aux plus puissants, tous les personnages ici, sympathiques ou haïssables, ont une profondeur, une complexité qui justifie leur temps à l’écran, et qui nous attache à leur destin. On n’en est certes pas encore au niveau de The Wire, mais quelque part, dans un registre certes plus « commercial », plus populaire, on s’en approche : bout à bout, les six saisons à date de Bosch constituent un riche portrait de la société angelena, des tensions qui agitent la ville comme de la bonne volonté des hommes et des femmes qui, quotidiennement, travaillent pour plus de justice dans un système qui ne les aide pas forcément.
C’est dans ce contexte que les derniers épisodes de la saison sont très beaux : au-delà de la tension finale autour de la scène assez convenue de l’attentat terroriste, c’est bien le terrible sentiment de tristesse qui conclut – ou pas – la plupart des fils narratifs de la saison qui en fait le prix. Oui, à la fin, il ne reste plus qu’à compter les morts. Et les illusions perdues. Il ne reste plus qu’à continuer.
Bravo.
![]()
Eric Debarnot
