Emily St John Mandel nous promène avec une troupe de théâtre dans un monde post-pandémie. Un livre subtil, mélancolique et tiède comme un après-midi d’automne qui nous rassure: le monde d’après finira bien par ressembler au monde d’avant.

La fin du monde fait peur — on ne sait pas trop pourquoi d’ailleurs. A cause de la mort ? Pourtant, la mort est insupportable pour ceux qui restent et il n’y aura plus personne quand le monde sera fini, personne pour pleurer ceux qui sont partis, pas même les animaux domestiques qui seront redevenus sauvages aussitôt le dernier humain disparu. A cause de la culpabilité, peut-être. Celle d’avoir crucifié, il y a longtemps, quelqu’un qui venait généreusement pour nous sauver ou celle d’avoir sacrifié les générations futures — même si je ne crois pas que beaucoup de parents se sentent coupable d’envoyer leurs nouveaux nés dans un monde pourri, pollué, sale et dangereux. La fin du monde fait peur, donc. Même si on ne sait pas pourquoi. Mais on sait que parce qu’elle fait peur, la fin du monde fascine, en particulier les écrivains qui nous font peur en la racontant. En racontant ce qui se passera après. On s’en est d’ailleurs beaucoup souvenu ce printemps 2020, quand nous étions (presque) tous confinés en attendant, peu-être que le monde finisse — mon préféré, que je n’ai pas beaucoup entendu mentionné reste All Fools Day, d’Edmond C. Cooper, une courte tête devant The Fugue for a Darkening Island, de Christopher Priest. Parmi les plus récents, il y a l’excellent Station Eleven d’Emily St John Mandel (finaliste 2014 du National Book Award ; lauréat 2015 du Arthur C. Clarke Award).
Un roman d’une actualité stupéfiante
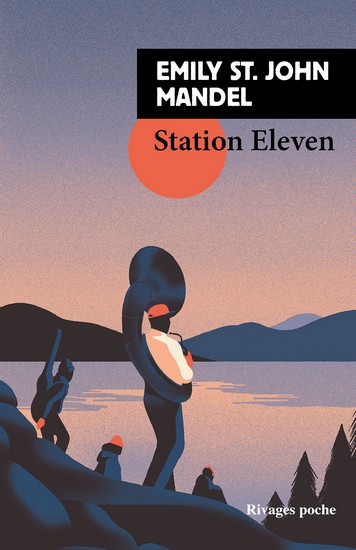 Publié en 2014 (publié en français sous le même titre en 2016), Station Eleven est un roman qui devait être lu quand il est sorti – il l’a été – et qui devrait être lu ou relu maintenant. Son actualité est stupéfiante. En tout cas le début : c’est une histoire de grippe qui tourne mal, très mal. En l’espace de quelques heures, quelques jours au maximum, tout est plié. Terminé. La grippe a fait son oeuvre. Il ne reste plus rien. Plus personne. Presque. Le monde est fini. Presque. L’histoire peut commencer. Elle commence dans la mort, la rupture, la surconsommation (il faut bien accumuler une dernière fois, stocker de quoi survivre quelques semaines avant de partir sur les routes à la découverte de ce qui reste, ceux qui restent). Et on retrouve les personnages 20 ans après, comme aurait dit Alexandre Dumas.
Publié en 2014 (publié en français sous le même titre en 2016), Station Eleven est un roman qui devait être lu quand il est sorti – il l’a été – et qui devrait être lu ou relu maintenant. Son actualité est stupéfiante. En tout cas le début : c’est une histoire de grippe qui tourne mal, très mal. En l’espace de quelques heures, quelques jours au maximum, tout est plié. Terminé. La grippe a fait son oeuvre. Il ne reste plus rien. Plus personne. Presque. Le monde est fini. Presque. L’histoire peut commencer. Elle commence dans la mort, la rupture, la surconsommation (il faut bien accumuler une dernière fois, stocker de quoi survivre quelques semaines avant de partir sur les routes à la découverte de ce qui reste, ceux qui restent). Et on retrouve les personnages 20 ans après, comme aurait dit Alexandre Dumas.
Je ne vais pas gâcher le plaisir de la lecture, de la découverte du roman, de l’intrigue, des personnages, de comment tout ça (le monde, l’humanité) finit (ou pas), de comment tout recommence (si tant est que cela recommence). Il faut le lire. L’histoire est connue. L‘intérêt du livre réside dans les détails. Il faut les découvrir, en plus de la construction sophistiquée, pleine d’allers-retours entre avant et après. Il faut découvrir ces coïncidences, ces résonances étonnantes après ce qu’on a vécu ces derniers mois. Disons juste qu’il y a quelque chose de tendre, de mélancolique dans le roman d’Emily St John Mandel, de cette mélancolie d’un dimanche après-midi d’automne qui finit, le soleil se couche, les arbres sont dorés, beaux et reposants, la brise est tiède. Il y a la nostalgie de l’été qui est passé et le sentiment que quelque chose est en train de mourir, de pourrir, mais aucune tristesse. De la sérénité, plutôt. C’est Station Eleven. Mélancolique et serein. Nostalgique.
Un monde fait de communautés où on mange surtout des animaux qu’on peut tuer
Station Eleven nous parle d’un monde où il n’y a plus d’avion ou d’électricité, plus d’internet ou d’ordinateur, plus de voiture, plus d’usines, plus de travail. Guère de chauffage, donc, à part au feu de bois. On y meurt, évidemment, quelques fois (rarement) de mort violente (le sang coule étonnamment peu, et les coups de feu sont rares et lointains). Même l’inévitable prophète, un illuminé dangereux et polygame, qui s’est forgé sa religion et sa conviction d’être un Élu en lisant bible ne fait pas vraiment peur — en tout cas, pas peur longtemps. Finalement, ce monde d’après est pacifié. On y vit en petits groupes, en communautés peu liées les unes aux autres mais sans conflits. Et on y mange surtout les animaux qu’on peut tuer.
Ah oui, dans ce monde d’après, la pollution a disparu mais pas grand monde ne semble être devenu végétarien. Non. En fait, ce monde d’après la fin du monde, qui est très différent du monde d’avant puisque tout a disparu n’est en fait pas si différent du monde d’avant. En fait, c’est la leçon de ce roman. Au moment où la grande question est celle de savoir comment nous allons organiser le monde d’après la pandémie du covid-19, Emily St John Mandel nous dit que, en l’année 20, les gens n’ont envie que d’une chose : recommencer comme avant, revenir au monde d’avant. Certains ont parlé d’espoir. Oui, l’espoir de recommencer. De la nostalgie, aussi.
C’est d’ailleurs souvent le cas dans les romans de pandémie et de mondes qui ne finissent pas vraiment : les survivants veulent reconstruire le monde d’avant, pas le changer, le reconstruire. C’est le cycle de la vie. 20 ans, donc. Finalement, peut-être que ce qui fait peur dans la fin du monde, c’est que cela recommence toujours. Et on en a envie.
![]()
Alain Marciano
Station Eleven
Roman de Emily St John Mandel
Gerard De Cherge (Traducteur)
Éditeur : PAYOT RIVAGES
550 pages – 22 euros
Parution: Août 2016
« Survivre ne suffit pas » : rencontre avec Emily St. John Mandel (Mauvais Genre / France Culture)
Conversation avec Emily St. John Mandel (medium.com)
