Comment raconter le deuil d’un père avant l’oubli ? Anne Pauly tente de répondre à cette question avec une certaine maladresse mais avec une grande justesse et une immense émotion. Un premier roman couronné du Prix du Livre Inter 2020.

Dans The Year of Magical Thinking, Joan Didion nous faisait le récit de la manière dont elle avait fini par accepter la disparition de John Gregory Dunne, son mari. Dans Avant que j’oublie, Anne Pauly nous raconte comme Anne Pauly – la narratrice qui porte le même nom que l’autrice – encaisse la disparition de son père. Comment cette « gouine gauchiste » – je cite – qui travaille en « nine to five » – je cite toujours et les italiques sont dans l’original – à corriger des textes écrits par d’autres, rencontre le croque-mort avec son frère, choisit la « boite » – encore une citation il n’y a pas de cercueil ici –, prépare la messe d’enterrement, apprend la maladie de son père – l’ordre du roman n’est pas chronologique. Puis vient la messe – dans une église « sold out », citation toujours et toujours les italiques de l’auteur –, l’enterrement lui-même – auquel participent ses « camarades gauchistes ». La difficulté de vider la maison de son père, de se séparer de tout ce qu’il avait entassé et qu’elle aurait probablement trouvé ridicule de son vivant mais qui est maintenant devenu indispensable. Et, enfin, la peine s’envole – littéralement.
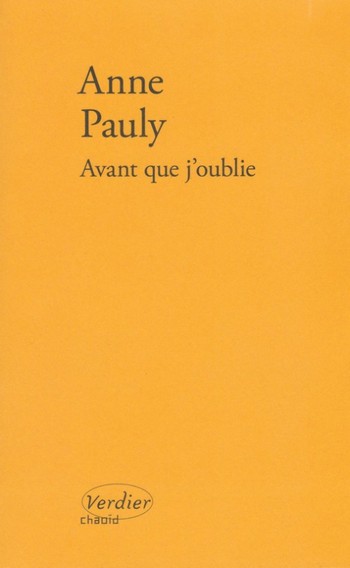 Je n’ai pas commencé cette chronique en parlant de Joan Didion pour suggérer une quelconque comparaison. Ce serait ridicule. Non seulement on ne compare pas des œuvres d’art, mais en outre tout oppose ces deux livres – à part peut-être qu’ils ont tous les deux été primés, le national book award en 2005 pour le premier et plein d’autres, dont le prix du livre Inter pour le second. J’ai ajouté cette référence à cause de la différence – précisément pour ça – dans la manière d’écrire sur le deuil. Pour moi, Joan Didion est une des écrivaines remarquables du 20e siècle. Son style est fantastique – sophistiqué mais précis, parfaitement équilibré. Pourtant, The Year of Magical Thinking ne m’a jamais vraiment ému – c’est plutôt ce manque d’émotion qui m’a gêné, d’ailleurs.
Je n’ai pas commencé cette chronique en parlant de Joan Didion pour suggérer une quelconque comparaison. Ce serait ridicule. Non seulement on ne compare pas des œuvres d’art, mais en outre tout oppose ces deux livres – à part peut-être qu’ils ont tous les deux été primés, le national book award en 2005 pour le premier et plein d’autres, dont le prix du livre Inter pour le second. J’ai ajouté cette référence à cause de la différence – précisément pour ça – dans la manière d’écrire sur le deuil. Pour moi, Joan Didion est une des écrivaines remarquables du 20e siècle. Son style est fantastique – sophistiqué mais précis, parfaitement équilibré. Pourtant, The Year of Magical Thinking ne m’a jamais vraiment ému – c’est plutôt ce manque d’émotion qui m’a gêné, d’ailleurs.
C’est tout l’inverse avec Avant que j’oublie – un premier roman est un premier roman et moi qui n’ai jamais écrit de roman, je ne vais pas donner de leçons. Mais je serais malhonnête si je disais que j’avais trouvé le style juste. Je n’ai pas aimé les expressions en anglais qui font dérailler l’histoire – y a vraiment des gens qui achètent des « random books » à Noël ? Ou les joues « décapées par les larmes » ou la lumière qui « déferle » dans le couloir ou la « boueuse portion de route éclairée par de méchants réverbères » qu’elle prend quand elle quitte le cimetière après l’enterrement. Je n’ai pas non plus compris ce que certaines situations venaient faire dans l’histoire – pourquoi la narratrice s’obstine-t-elle à organiser une messe alors que de toute évidence elle n’a pas une opinion très élevée de l’église ? Pour rendre hommage à son père ? Pour révéler à son amie Félicie quelque chose qu’elle ne connaissait pas d’elle ? Des exemples sortis de leur contexte ? Peut-être. Un style, je pense, qui crée de la confusion. Je me suis dit que cela pouvait rendre compte de l’état d’esprit de la narratrice. Je n’y crois pas trop. Pourtant…
Pourtant, il a suffit quelques pages de lecture pour que je me retrouve quelques dizaines d’années en arrière, ramené à la maladie incurable de mon père, à son décès et à son enterrement. Les images qui illustraient dans mon esprit les mots d’Anne Pauly étaient celles de ma propre histoire, une histoire que je revivais en lisant celle d’une autre. Je me suis alors rendu compte que, contrairement à la narratrice, je n’avais passé les dernières heures de la vie de mon père à l’hôpital avec lui – et que je ne m’étais jamais demandé comment ça s’est passé pour lui ! Je n’avais pas eu, contrairement à la narratrice, de cercueil à choisir, de messe pendant laquelle pleurer, pas de vielle amie de mon père – ici, elle s’appelle Juliette – qui m’écrive pour me dire tout le bien qu’elle pensait de lui, pas de repas en famille pour évacuer la peine de l’enterrement, pas de maison à vider, pas de… Toutes ces choses que je n’ai pas vécues. J’en aurai presque pleuré.
Kafka aurait dit – une référence probablement fausse pour un vrai jugement – que la seule littérature qui mérite d’être lue est celle qui prend aux tripes. Avant que j’oublie ne m’a pas pris aux tripes. Il m’a pris par la main pour m’emmener dans des endroits où je n’étais jamais allé après la mort de mon père et me faire ressentir des émotions jamais vécues. Il m’a fait comprendre ce qu’est le deuil. C’est probablement aussi la marque d’un grand roman.
![]()
Alain Marciano
