Aaron Sorkin s’empare de l’emblématique procès des sept de Chicago et signe un film passionnant où le verbe sorkinien fait une fois de plus merveille, mais sans se départir d’un manque d’ambition et d’un certain académisme.

D’abord un peu d’histoire, un peu de contexte : lors de la Convention nationale démocrate de 1968 qui se déroula à Chicago, de nombreuses manifestations contre la guerre du Vietnam et la politique du président Lyndon B. Johnson se déroulèrent un peu partout dans la ville. Il y eut évidemment des conflits avec une police particulièrement féroce, chauffée à blanc par le maire de la ville. Après les heurts, on arrêta les organisateurs de plusieurs manifestations (Abie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden, Rennie Davis, David Dellinger, John Froines et Lee Weiner) que l’on décida de juger, entre autres, pour conspiration et incitation à la révolte.
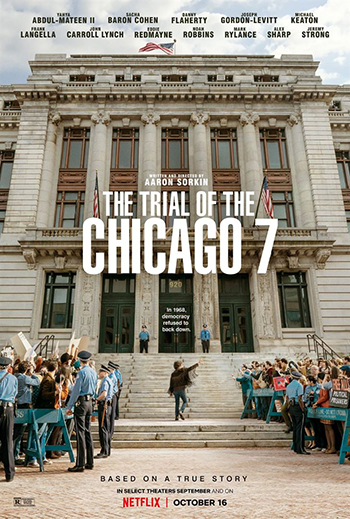 On « jugea » également avec eux Bobby Seale (malgré l’absence de son avocat et de droit de parole), cofondateur du Black Panther Party, lors d’un procès qui, loin des procédures judiciaires habituelles, se révélera avant tout procès politique. Le but ? Marquer le coup et se débarrasser de cette gauche contestataire que Nixon et Hoover considèrent comme les « les pires ennemis de l’Amérique ». Projet de longue date qu’Aaron Sorkin traîne depuis la fin d’À la Maison Blanche en 2006, Les sept de Chicago a connu diverses mésaventures de production avant de pouvoir, en 2018 et sous l’impulsion de Steven Spielberg, être réalisé et diffusé à quelques jours des élections américaines.
On « jugea » également avec eux Bobby Seale (malgré l’absence de son avocat et de droit de parole), cofondateur du Black Panther Party, lors d’un procès qui, loin des procédures judiciaires habituelles, se révélera avant tout procès politique. Le but ? Marquer le coup et se débarrasser de cette gauche contestataire que Nixon et Hoover considèrent comme les « les pires ennemis de l’Amérique ». Projet de longue date qu’Aaron Sorkin traîne depuis la fin d’À la Maison Blanche en 2006, Les sept de Chicago a connu diverses mésaventures de production avant de pouvoir, en 2018 et sous l’impulsion de Steven Spielberg, être réalisé et diffusé à quelques jours des élections américaines.
Objectif revendiqué par Sorkin afin de mettre les événements du film en résonance avec l’actualité US à l’heure de Trump, de Black Lives Matter, des fake news et des suprémacistes blancs. Il s’agit donc pour Sorkin de questionner l’indépendance de l’appareil judiciaire américain à travers la figure de l’impitoyable juge Hoffman (et ses multiples écarts) et la légitimité d’une lutte, ou plutôt d’idées, ou plutôt leurs moyens d’action en confrontant par exemple ceux d’Hoffman et de Rubin, trublions hippies prônant orgies et LSD, à ceux d’Hayden et de Davis, étudiants propres sur eux tout juste échappés des jupes de maman.
Le verbe sorkinien fait mouche une fois de plus, servant à merveille une écriture dense (mais toujours fluide) et les nombreuses joutes, entre les différents protagonistes, qui cimentent le film. Verbe sorkinien haut en couleur (what else?), et surtout verbe tout court que Sorkin va méthodiquement décliner : célébré (le stand-up d’Hoffman), trahi (Dillinger, pacifiste dans l’âme qui prône la non-violence à son fils pour finalement, lors du procès, frapper un huissier de justice à force d’exaspération), détourné (la phrase-clé d’Hayden, mal interprétée et sortie de son contexte), respecté (la liste des soldats morts au Vietnam) ou même empêché (Seale que l’on bâillonne, littéralement).
Prétoire et parades militantes deviennent les lieux d’une parole plurielle, parole dans tous ses états qui, in fine et sans que l’on puisse l’arrêter, servira à rendre hommage aux sacrifiés d’une guerre, cette guerre contre laquelle ces sept-là avaient simplement (naïvement ?) décidé de « porter des idées de liberté et de paix ». Sorkin ne renouvelle pas pour autant le film de procès, genre en soi si cher, si ancré à son pays. Il reste clairement dans sa zone de confort, manque parfois d’ambition, flirte même avec un doux académisme, mais sa façon bien à lui de décortiquer les dérèglements d’un système démocratique, et l’implication totale d’un casting qui en met plein la vue (Sacha Baron Cohen et Eddie Redmayne en tête, et surtout Frank Langella en juge sinistre et impartial), font de ces Sept de Chicago, à défaut d’une œuvre marquante, un rappel bienvenu d’un temps de l’Histoire troublé par la violence et les contradictions, et condamné à se répéter.
![]()
Michaël Pigé
