On imaginait bien que Todd Haynes, réalisateur talentueux et peu conventionnel ne livrerait pas à Apple un film « normal » sur le Velvet Underground : son documentaire désorientera de nombreux téléspectateurs mais s’avère régulièrement magnifique.

Et si le Velvet Underground était le groupe le plus important de l’histoire du Rock ? Oui, plus que les Beatles, que Pink Floyd ou Led Zep ! C’est une hypothèse qui se défend parce que, si l’on analyse honnêtement la situation au cours des vingt à trente dernières années, les deux tiers des groupes de Rock actifs sur la planète jouent de la musique plus ou moins directement inspirée de ce truc assez incroyable que Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison et Moe Tucker ont inventé ensemble à New York entre 1965 et 1967. Bien sûr, ce qui est rageant – mais il faut s’y faire, car le temps passe, qui ne nous attend pas, et n’est pas de notre côté – c’est qu’une vaste majorité de jeunes gens d’aujourd’hui, et même parmi les mélomanes, ne connait rien du Velvet (et même le nom du groupe, on se demande parfois…). Dans ce contexte d’oubli accéléré, frôlant l’amnésie, on pourrait dire que la sortie d’un « documentaire » réalisé par un réalisateur du calibre de Todd Haynes – par ailleurs grand fan de Rock – s’imposait : on pouvait espérer un film qui fasse le panégyrique du groupe, et rappelle combien la musique contemporaine doit au Velvet Underground…
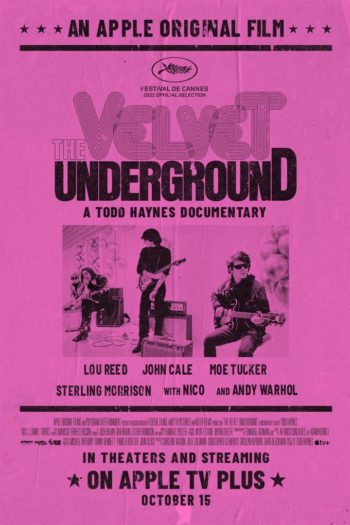 Sauf que, bien entendu, une analyse rapide de l’œuvre – magnifique – de Todd Haynes permettait d’anticiper un film qui n’a pas grand-chose à voir avec un documentaire traditionnel : de sa réflexion décalée et fantasmée sur les rapports entre Bowie, Iggy Pop et Lou Reed (Velvet Goldmine) à sa représentation symbolique de Bob Dylan à travers de multiples personnages (I’m Not There), en passant par sa sublime utilisation de Space Oddity dans Wonderstruck, il était facile d’imaginer que Haynes ne se contenterait pas d’un storytelling conventionnel, et ferait un VRAI film. Les premières réactions ennuyées et souvent courroucées de spectateurs « laissés en rade » par The Velvet Underground, qu’ils jugent complètement incompréhensible, ou tout au moins dénué du minimum nécessaire d’informations sur le groupe, confirme avant même de voir le film que l’on sera en présence d’un nouvel OVNI.
Sauf que, bien entendu, une analyse rapide de l’œuvre – magnifique – de Todd Haynes permettait d’anticiper un film qui n’a pas grand-chose à voir avec un documentaire traditionnel : de sa réflexion décalée et fantasmée sur les rapports entre Bowie, Iggy Pop et Lou Reed (Velvet Goldmine) à sa représentation symbolique de Bob Dylan à travers de multiples personnages (I’m Not There), en passant par sa sublime utilisation de Space Oddity dans Wonderstruck, il était facile d’imaginer que Haynes ne se contenterait pas d’un storytelling conventionnel, et ferait un VRAI film. Les premières réactions ennuyées et souvent courroucées de spectateurs « laissés en rade » par The Velvet Underground, qu’ils jugent complètement incompréhensible, ou tout au moins dénué du minimum nécessaire d’informations sur le groupe, confirme avant même de voir le film que l’on sera en présence d’un nouvel OVNI.
Et Todd Haynes fait en effet très fort : dans une longue introduction qui plante le décor musical (beaucoup) et familial (un peu) de Lou Reed et de John Cale, il va nous offrir un feu d’artifice d’images et de sons, usant brillamment du split screen et réalisant une parfaite osmose entre effets visuels et musicaux. Cette première partie de The Velvet Underground est à la fois grisante et déstabilisante : le cinéphile en nous apprécie et reconnaît le talent formel de Haynes, le fan du Velvet (ou le néophyte, donc…) trépigne d’impatience. On savoure la passion de Cale – et de Haynes, visiblement, pour John Cage, La Monte Young et leur approche révolutionnaire de la musique, qui nourrira les drones des deux premiers albums du groupe, mais on attend quand même avec impatience qu’Andy Warhol entre en scène et que les « choses sérieuses » commencent…
Le cœur de The Velvet Underground est, logiquement, la rencontre entre le groupe et Warhol, leur intégration dans l’œuvre multimédia de l’artiste et dans l’univers baroque de la Factory. Sans déroger de son principe de ne rien expliquer, de ne fournir aucun contexte au néophyte qui n’aurait pas les connaissances élémentaires sur cette période, ou sur les artistes et performers qui défilent à toute allure sur l’écran fragmenté, Haynes nous abreuve d’images inédites, souvent stupéfiantes : la question qui se pose est évidemment : « pourquoi n’avons-nous pas vu avant ces photos, ces films, qui en montrent autant sur notre groupe favori, à une étape-clé de sa trajectoire ? » Bref, le fan et le connaisseur exultent, les autres auront probablement déjà décroché devant l’enchaînement d’interviews de gens dont ils ignoraient l’existence (pas de mention à l’écran de qui sont les personnes interviewées, il faut attendre le générique de fin…) et le name dropping de parfaits inconnus… et ils seront passé à autre chose…
Et puis la narration s’accélère dans la dernière ligne droite, parfois audacieuse (le silence sur les images relatives à l’attentat contre Andy), parfois juste négligente : on peut trouver que l’on passe trop vite sur les troisième et quatrième albums, on peut aussi rager devant le fait de voir la carrière de Lou Reed traitée en une vingtaine de photogrammes défilant à toute allure, même si ce n’était clairement pas le sujet du film). Il est alors temps de faire le bilan : Jonathan Richman nous a touché – comme toujours, dira son public fidèle – en livrant un témoignage drôle et passionné de l’impact que cette musique a pu avoir sur lui, et sur… nous ; John Cale et Moe Tucker, les deux survivants, ont gardé une classe et une lucidité qui anoblissent le film ; on n’a malheureusement pas entendu de musiques nouvelles (l’héritage du Velvet ayant été, lui, bien exploré…) mais on s’est régalé de nombreuses nouvelles images destinées à devenir iconiques.
On pourra toujours tiquer sur une sorte de révisionnisme bienveillant du discours de Haynes, qui a tendance à minimiser, au moins par rapport à ce qu’on a pu lire avant et ailleurs, les conflits qui ont émaillé la courte vie du groupe – avec Warhol, autour de Nico, et bien sûr entre les membres du groupe. Mais lorsque dans les toutes dernières minutes du film, on revoit et réécoute Lou, John et Nico jouant ensemble Heroin sur la scène de notre cher Bataclan en 1972, il est difficile de ne pas se sentir submergés par l’émotion que la démarche, très conceptuelle, de Todd Haynes a tenu à l’écart jusque-là.
![]()
Eric Debarnot
