Nous n’étions pas très optimistes quant à la perspective de voir se conclure Ozark, après les errements scénaristiques des dernières années. Nous avions tort, et la conclusion de cette série devenue très populaire outre-Atlantique nous réconcilie avec elle.

A la différence de certains, qui se sont extasiés devant l’accélération scénaristique délirante de la première partie de la quatrième saison de Ozark, l’une des séries Netflix les plus regardées aux USA, il fait le rappeler, nous avons déploré le mauvais virage pris par l’œuvre de Bill Dubuque, Mark Williams et Jason Bateman (qui, s’il n’était pas showrunner, a été très impliqué dans la production, la réalisation et l’interprétation, bien entendu) : pourquoi un tel changement d’atmosphère, une telle accélération des péripéties, qui en devenaient abracadabrantes, aberrantes ? Pour capturer plus de téléspectateurs, addicts aux thrillers survitaminés, et qui roupillaient sur leur sofa devant une série privilégiant l’atmosphère et les ambiguïtés psychologiques ?
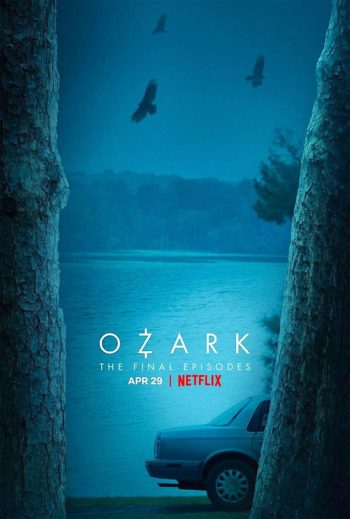 Autant dire qu’après une troisième saison déjà déclinante et 7 épisodes de la dernière saison qui frôlaient tour à tour le ridicule (plus aucune crédibilité dans les rapports de Wendy et Marty Byrde avec le cartel mexicain, le FBI, la multinationale pharmaceutique ou les milieux politiques…) et l’épuisant (un basculement complet de la situation toutes les 20 minutes ou presque), on n’attendait plus grand-chose de cette conclusion, si ce n’est la triste fin d’une série qu’on avait espéré un moment voir tutoyer les sommets de Breaking Bad.
Autant dire qu’après une troisième saison déjà déclinante et 7 épisodes de la dernière saison qui frôlaient tour à tour le ridicule (plus aucune crédibilité dans les rapports de Wendy et Marty Byrde avec le cartel mexicain, le FBI, la multinationale pharmaceutique ou les milieux politiques…) et l’épuisant (un basculement complet de la situation toutes les 20 minutes ou presque), on n’attendait plus grand-chose de cette conclusion, si ce n’est la triste fin d’une série qu’on avait espéré un moment voir tutoyer les sommets de Breaking Bad.
Et puis, non : dans la dernière ligne droite, et sans retourner malheureusement vers l’épure des débuts, Ozark se reprend, sauve les meubles, et nous laisse avec (presque) des regrets. Il y a d’abord un excellent premier (huitième, pardon) épisode qui replace la bouleversante Ruth (Julia Garner, parfaite…) au cœur de la saison, où elle restera jusqu’aux dernières minutes de la conclusion. Et il y a ensuite, même si tous les excès de la première partie ne sont pas gommés, le fait que l’histoire se concentre d’une part sur l’affrontement entre Wendy – de plus en plus terrifiante de froideur et de dysfonctionnements – et son père indigne – un formidable personnage que vous aimerez haïr -, et de l’autre sur le danger mortel que représente désormais Camila (la sœur d’Omar Navarro et la mère de Javi…) pour les Byrde, qui doivent déployer toutes les stratégies imaginables pour se sortir du guêpier où ils se sont jetés.
Oui, lorsque ces deux fils narratifs se rejoignent, dans les deux derniers épisodes impeccables, on retrouve notre amour pour Ozark. On sait que la conclusion a été largement rejetée par les téléspectateurs US, parce qu’elle n’est pas assez moralisante, pas assez claire, pas assez manichéenne : pourtant, ce dernier coup de feu alors que l’image est devenue noire nous semble magistral, presque au niveau de l’incroyable fin suspendue des Soprano. Il résonne comme une condamnation sans appel de la perte de tous les repères moraux et éthiques de Wendy et Marty Byrde, dont l’avidité (le rêve américain) a conduit à la destruction totale de tout ce qu’ils aimaient, leur famille, leurs amis, leurs proches. Il est le son définitif de la plus amère des victoires, qui a été atteinte au prix d’une déshumanisation totale.
Terriblement pessimiste, cette conclusion confère toute sa valeur à Ozark, et nous amène même à pardonner les excès scénaristiques qui ont précédé.
![]()
Eric Debarnot
