Si The Fabelmans n’appartient aucunement aux réussites majeures d’une filmographie comportant au moins une dizaine de chefs d’œuvre / classiques, il vaut pour ce qu’il raconte des rapports entre l’intime et une vocation de cinéaste.

Le temps où Spielberg donnait le La de la Pop Culture américaine est désormais révolu. Son remake de West Side Story et ce The Fabelmans ont tous deux fait un flop au Box Office américain en dépit de critiques élogieuses. D’autres cinéastes l’ont remplacé comme figure de wonderboy du cinéma hollywoodien : Shyamalan dans les années 2000, Jordan Peele désormais. En partie inspiré par sa jeunesse et ses années de formation de cinéaste, The Fabelmans est le premier film coscénarisé par Spielberg depuis A.I. Intelligence Artificielle. Et s’inscrit dans un genre hautement américain : le coming of age.
 J’aurais bien voulu éviter de faire ici du discours sur le cinéma à travers le film. Mais, même en mettant de côté la vraie vie de Spielberg, le (meilleur du) film concerne d’abord la manière dont la cinéphilie et la vocation de cinéaste interagissent avec la vie intime de son héros Sammy Fabelman. Ces dernières ayant été en partie déclenchées par la cellule familiale. C’est en revisionnant un film, en faisant varier la vitesse de l’image, en observant le cadre à plusieurs reprises que Sammy découvrira la réalité derrière le vernis de sa vie de famille. La vocation de cinéaste est la bouée qui lui permettra de tenir face aux crises dans le foyer, aux changements contraints et aux brimades dans son existence. Et plus tard la capacité du cinéma à sublimer le réel sera l’instrument d’une vengeance involontaire. C’est le talent de Spielberg à mettre en forme tout cela (au propre et au figuré) qui évitent au film le théorique.
J’aurais bien voulu éviter de faire ici du discours sur le cinéma à travers le film. Mais, même en mettant de côté la vraie vie de Spielberg, le (meilleur du) film concerne d’abord la manière dont la cinéphilie et la vocation de cinéaste interagissent avec la vie intime de son héros Sammy Fabelman. Ces dernières ayant été en partie déclenchées par la cellule familiale. C’est en revisionnant un film, en faisant varier la vitesse de l’image, en observant le cadre à plusieurs reprises que Sammy découvrira la réalité derrière le vernis de sa vie de famille. La vocation de cinéaste est la bouée qui lui permettra de tenir face aux crises dans le foyer, aux changements contraints et aux brimades dans son existence. Et plus tard la capacité du cinéma à sublimer le réel sera l’instrument d’une vengeance involontaire. C’est le talent de Spielberg à mettre en forme tout cela (au propre et au figuré) qui évitent au film le théorique.
https://www.youtube.com/watch?v=DpB_m3VvxAM
Les scènes de tournage de films amateurs ont elles un charme dû à l’emploi de trucages rudimentaires dignes d’une série Z et de moyens pour le moins artisanaux de photographier un film. Elles évoquent en partie un Super 8 qui serait filmé par un metteur en scène au talent plus étendu qu’Abrams. Et comme espéré David Lynch campe le temps d’une scène un John Ford mémorable. Tout ce qui concerne les drames intimes a en revanche, en dépit d’un score de John Williams excellent et sobre, quelque chose de surchargé dans le pathos. La partie adolescente ressemble de plus à une caricature de teenage movie. Et être plus convaincant comme film sur le cinéma que comme film sur un traumatisme vécu est problématique au vu de la nature d’autobiographie romancée du projet.
La fin du film est à la fois une leçon sur l’art de filmer et un début d’arrivée à bon port. Elle ne fait pas oublier les imperfections du scénario de Spielberg et Kushner. Mais elle ne fait pas regretter le voyage.
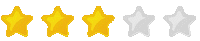
Ordell Robbie
