Quand des cracks de la musique contemporaine se retrouvent pendant quelques jours pour composer un album, cela donne Black Bay, un exemple de ce qu’il peut y avoir de mieux en matière de post-rock, symphonique et planant, mélodique et grandiose, puissant et émouvant.

Prenez quelques musicos assez balèzes, faites les jouer ensemble pendant quelque temps, saupoudrez de quelques tweets, plus deux ou trois autres musiciens assez relevés aussi, faites mijoter (pas très longtemps, la qualité des ingrédients est suffisante) dans un endroit superbe au bout du monde et vous obtiendrez un album fantastique. C’est exactement ce qui est arrivé à Silver Moth. Au départ, il y a Stuart Braithwaite (oui, celui-là même, le seul et unique, guitariste et chanteur de Mogwai) et Elisabeth Elektra, sa femme, Evi Vine, Steven Hill, qui ont commencé à improviser des morceaux ensemble. Quelques tweets et rendez-vous en ligne plus tard (on vous épargne le couplet sur le côté super-positif des réseaux sociaux), en particulier avec Mathew Rochford (Abrasive Trees), et aussi Ash Babb (Burning House, Academy Of Sun), batterie, Ben Roberts (Prosthetic Head), violoncelle, et l’idée de s’isoler pour composer un album avait pris forme. C’est dans les studios Black Bay de Great Bernera sur l’île de Lewis, à l’ouest de l’écosse dans les Hébrides orientales, qu’ils se sont finalement confinés. Le paysage est énorme, l’ambiance est au recueillement et au travail, à la création. Elisabeth Elektra dira à propos de ce moment : « We didn’t know each other before we went to Black Bay (On ne se connaissait pas avant d’aller à Black Bay), et donc « We went into a really intense creative mode as soon as we got there. We were in a bubble and there was a lot of collective grief going on, so it was like a pressure cooker (Nous sommes entrés dans un mode créatif vraiment intense dès que nous y sommes arrivés. Nous étions dans une bulle et il y avait beaucoup de chagrin collectif, donc c’était comme une cocotte-minute)». Et en 4 jours, oui, en moins de temps qu’il faut pour le dire, Black Bay était donc plié. Bluffant, quand même.
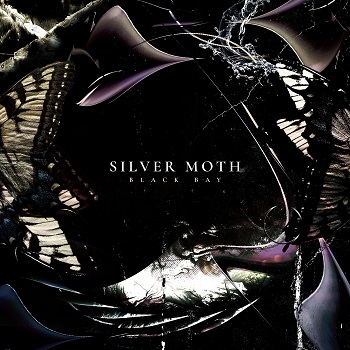 D’autant plus bluffant que le résultat est fantastique. Comme le dit Elisabeth Elektra encore, « I think some real beauty came out of it (Je pense qu’une vraie beauté en est sortie). » Difficile de ne pas être d’accord. Un hommage à la musique, à ce ce qui fait le charme et la magie, du post-rock : l’ampleur et la puissance des montées de guitare, le calme aussi, méditatif et quasi-mystique en particulier apporté par les voix. Cet album est un voyage qui vous conduira au bout du monde, une expérience physique et personnelle aussi. Et un hommage au lieu. L’album est porté, hanté, par l’île de Lewis. Mathew Rochford l’a écrit dans son journal, « Lewis is such a special place to have done this. A landscape that shapeshifts with the ever-changing light, the weather pouring in from the Atlantic, stories of Kelpies, soaring sea eagles, whalebone arches, Luskentyre, the sweetness of peat smoke, the poems from my father, the lochs that move from black to gold to pink as the sun moves across these expansive skies. (Lewis est un endroit vraiment spécial pour avoir provoqué cela. Un paysage qui change de forme avec une lumière en constante évolution, le temps affluant de l’Atlantique, les histoires de Kelpies, les aigles de mer en plein essor, les arches en fanon de baleine, Luskentyre, la douceur de la fumée de tourbe, les poèmes de mon père, les lochs qui passent du noir de l’or au rose alors que le soleil se déplace dans ces vastes cieux.»
D’autant plus bluffant que le résultat est fantastique. Comme le dit Elisabeth Elektra encore, « I think some real beauty came out of it (Je pense qu’une vraie beauté en est sortie). » Difficile de ne pas être d’accord. Un hommage à la musique, à ce ce qui fait le charme et la magie, du post-rock : l’ampleur et la puissance des montées de guitare, le calme aussi, méditatif et quasi-mystique en particulier apporté par les voix. Cet album est un voyage qui vous conduira au bout du monde, une expérience physique et personnelle aussi. Et un hommage au lieu. L’album est porté, hanté, par l’île de Lewis. Mathew Rochford l’a écrit dans son journal, « Lewis is such a special place to have done this. A landscape that shapeshifts with the ever-changing light, the weather pouring in from the Atlantic, stories of Kelpies, soaring sea eagles, whalebone arches, Luskentyre, the sweetness of peat smoke, the poems from my father, the lochs that move from black to gold to pink as the sun moves across these expansive skies. (Lewis est un endroit vraiment spécial pour avoir provoqué cela. Un paysage qui change de forme avec une lumière en constante évolution, le temps affluant de l’Atlantique, les histoires de Kelpies, les aigles de mer en plein essor, les arches en fanon de baleine, Luskentyre, la douceur de la fumée de tourbe, les poèmes de mon père, les lochs qui passent du noir de l’or au rose alors que le soleil se déplace dans ces vastes cieux.»
Henry, l’ouverture, peut avoir quelques accents mogwaiens (et c’est bien le seul de l’album, d’ailleurs), par ses jeux de guitare très mélodiques, son côté à la fois mélancolique et sombre – le violoncelle de Ben Roberts et la voix d’Evi Vine – et l’explosion sonore soudaine qui vous submerge et vous ensevelit soudain avant une fin tout en douceur. L’album est lancé. Les morceaux qui suivent alterneront de la même manière les moments lents et méditatifs, avec les déferlements puissants dans lesquels tous les instruments semblent se déchaîner.
Sur The Eternal, Elisabeth Elektra pleure la perte de son amie Alanna, un hommage porté par des roulements de tambours et des cymbales et des harmonies puissantes. Mother Tongue est plus psychédélique, fin des années 1960, Pink Floyd, décliné dans une version gaélique. Même côté gaélique, évidemment, sur Gaelic Psalms, un poème de Gerard Rochford (1932-2019), le fameux poète et père de Matthew qui dit le poème, sur un fond de clapotis d’eau… le morceau le plus court de l’album, et probablement le plus méditatif, un hommage à l’île de Lewis.
Une respiration bienvenue avant ce qui est probablement la pièce de résistance de l’album : Hello Doom – quel titre quand même ! – 15 minutes, un morceau dévastateur qui commence lentement avec quelques arpèges discrets et légers (et quelques effets de guitare) qui montent en puissance lentement, la voix comme une plainte, une lamentation, le violoncelle dans le fond, avant que la guitare ne se déchaîne, que la batterie ne s’ajoute, et le morceau est lancé dans une sorte de course folle dans laquelle chaque instrument pousse les autres, le son monte, 5 minutes d’énergie tellurique, et le morceau se calme de nouveau… Une ambiance de désolation (comme sur certains morceaux de God Speed You Black Emperor). Hello Doom est exaltant mais épuisant.
Plus, en tout cas, que Sedna, le morceau qui clôture ce Black Bay. Elisbeth Elektra chante un hommage aux Hébrides et à la mer. Des arpèges de guitare qui ouvrent avant que les autres instruments n’arrivent, nappes de synthé et violoncelles, les cymbales, pour donner cette ampleur et ce rythme si caractéristique du post-rock. Un autre morceau fort et puissant, sur un album qui n’en manque pas. Une réussite, sur un album parfaitement maîtrisé, vaste comme l’océan qui entoure l’île où se trouve ce studio magique.
![]()
Alain Marciano
