Comme tous les films récents de Nuri Bilge Ceylan, les Herbes Sèches est un long parcours qui se mérite, mais qui doit se nourrir de cette patience pour une escalade finale vers le sublime.

Nuri Bilge Ceylan appartient à cette catégorie de cinéastes dont le nouveau film fait à chaque fois figure de retrouvailles : on reconnait, dès son superbe plan d’ouverture où un homme marche dans la neige, ce cinéma ample et contemplatif, où la splendeur mutique des décors entrera en friction avec les longues et douloureuses dissertations du langage humain.
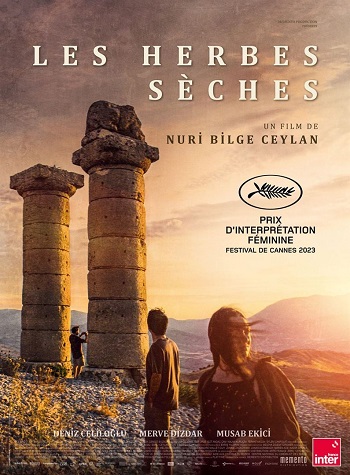 Son cinéma se mérite : long (ses trois derniers films dépassent les 3 heures), dense, il explore en outre les contradictions d’individus qui, sous le couvert de déclarations, révèlent par leurs actes ou leur inertie une mesquinerie, voire une bassesse propre à définir la condition humaine. C’était déjà le cas des écrivains de Winter Sleep et Le Poirier Sauvage, et ce le sera pour Samet, professeur d’arts plastiques dans un collège perdu au milieu de la campagne enneigée, persuadé que la médiocrité de son existence tient à l’endroit où on l’a catapulté. D’une éthique professionnelle assez douteuse, la confrontation à certains de ses actes va le plonger dans le déni et le mensonge, avant que ces réflexes ne viennent aussi contaminer sa vie privée dans une entreprise de séduction motivée surtout par la jalousie et l’orgueil.
Son cinéma se mérite : long (ses trois derniers films dépassent les 3 heures), dense, il explore en outre les contradictions d’individus qui, sous le couvert de déclarations, révèlent par leurs actes ou leur inertie une mesquinerie, voire une bassesse propre à définir la condition humaine. C’était déjà le cas des écrivains de Winter Sleep et Le Poirier Sauvage, et ce le sera pour Samet, professeur d’arts plastiques dans un collège perdu au milieu de la campagne enneigée, persuadé que la médiocrité de son existence tient à l’endroit où on l’a catapulté. D’une éthique professionnelle assez douteuse, la confrontation à certains de ses actes va le plonger dans le déni et le mensonge, avant que ces réflexes ne viennent aussi contaminer sa vie privée dans une entreprise de séduction motivée surtout par la jalousie et l’orgueil.
Accompagner cet homme n’aura donc rien d’agréable, que ce soit dans son comportement tendancieux à l’égard d’une collégienne, ou le cynisme avec lequel il s’oppose à ceux qui l’exhortent à l’action, au fil de longs blocs de dialogues qui semblent renouer avec les débats du temps de l’existentialisme.
En contrepoint de cet éprouvant écoulement du temps, dissection laissant peu de chances au protagoniste, Ceylan poursuit son exploration du monde muet qui l’entoure. De temps à autre, des clichés photographiques apparaissent, sublimes parenthèses d’un monde sans parole, où les visages délivrent les promesses d’une croyance encore possible en la beauté et la bonté – un motif central, qui irriguera l’un des derniers plans du film. C’est dans cette tension entre la mise en scène et le matériau proprement littéraire et verbal que se joue tout le fragile équilibre de l’œuvre du cinéaste : aux plans fixes austères succèdent progressivement l’arrivée de mouvements, jusqu’à certaines étonnantes ruptures, approches irrégulières vers des épiphanies qu’on aura volontairement différées. Les échanges se fluidifient et l’inertie du protagoniste vacille, confrontée à son reflet et aux questions posées par une femme qui saura l’exposer aux réelles violences d’un monde qu’il préfère maintenir à distance.
Il ne faut pas pour autant s’attendre à une progression linéaire : l’écriture de Ceylan est une exploration sans concession des contradictions, et fait de la désillusion une dynamique centrale. Ainsi de cette terrible scène d’amour en forme de capitulation désenchantée et glaciale, à laquelle répondra une brèche encore plus grande lorsque le protagoniste quitte la pièce pour parcourir le studio et adresser un regard caméra d’une lucidité déstabilisante.
Cette obsession à vouloir décaper la comédie humaine et atteindre la vérité pourrait servir le nihilisme le plus radical ; il n’en est rien. A l’image de cette source où les deux amis viennent, au terme d’une randonnée qui les mène aux sommets des montagnes, recueillir goutte à goutte une eau pure, le récit distille encore des soupirs de beauté : il faut encore, même mutilé, marcher et arpenter le monde. A bien les observer, on prendra conscience que certaines des photographies s’animent légèrement, à l’image du frimas bouleversant qui animait un unique plan de La Jetée de Chris Marker. C’est dans cette attention portée à l’insignifiant, à cette herbe sèche qui n’aura pas eu le temps de croître, étouffée par la neige tardive de l’hiver, que se loge la possibilité d’un modeste salut. « Tout ce qui est beau dans ce monde semble s’accrocher aux toiles qu’on tisse nous-même et jamais parvenir jusqu’à nous », affirme Nurray, avant que le monologue final, accompagnant l’ascension d’une colline inondée de lumière, ne vienne reconnaitre l’existence de certaines splendeurs, comme celle d’une enfant qui garderait en elle toute l’innocence de l’humanité.
Le cinéma de Ceylan se mérite ; celui qui s’y aventure aura toutes les chances de s’y voir confronté au sublime, comme parvient à le faire ce personnage abimé qui, en trébuchant, saisit encore les traces de beautés jonchant le sol d’un monde aussi fatigué que lui.
![]()
Sergent Pepper
