Huit ans après Station Eleven, son bestseller traduit dans plus de trente langues et vendu à plus d’un million d’exemplaires, la Canadienne Emily St. John Mandel revient à la science-fiction avec son très beau nouveau roman, La Mer de la tranquillité. Elle s’y approprie avec subtilité le thème du voyage dans le temps et nous offre un récit aussi émouvant que stimulant.

Comment faire du neuf avec du vieux ? Peut-on encore intéresser le lecteur avec un thème aussi éculé que celui du voyage dans le temps ? Dès les premières pages de La Mer de la tranquillité, Emily St. John Mandel rassure le lecteur le plus réticent en racontant dans un style ample et élégant (magnifiquement traduit par Gérard de Chergé) l’histoire d’Edwin St. John St. Andrew. En 1912, ce jeune Anglais oisif vient d’arriver au Canada, un territoire encore largement méconnu et où le jeune homme peine à donner un sens à son existence. À la suite de cette première partie, a priori très éloignée des thématiques traditionnelles de la science-fiction, Emily St. John Mandel va s’attacher à trois autres personnages. En 2020, Mirella Kessler a bien du mal à surmonter la mort de son mari qui s’est suicidé après avoir été ruiné par son meilleur ami, un escroc qui a fui à Dubaï. Puis nous faisons la connaissance d’Olive Llewellyn, une romancière qui en cette année 2203 assure la promotion de son roman d’anticipation Marienbad, dans lequel elle évoque une pandémie mondiale. Enfin, il y a Gaspery Roberts qui vit en 2401 dans les colonies lunaires et dont la sœur Zoey travaille à l’Institut du Temps.
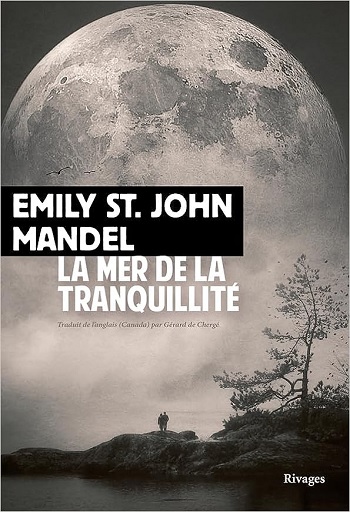 Tous ces destins sont toutefois reliés par un étrange phénomène, une sorte d’hallucination visuelle et auditive qui se répète à travers le temps. Zoey est convaincue qu’il s’agit d’une anomalie qui pourrait valider l’hypothèse selon laquelle notre monde n’est qu’une simulation. Pour le prouver, il n’y a qu’une solution : remonter l’axe du temps.
Tous ces destins sont toutefois reliés par un étrange phénomène, une sorte d’hallucination visuelle et auditive qui se répète à travers le temps. Zoey est convaincue qu’il s’agit d’une anomalie qui pourrait valider l’hypothèse selon laquelle notre monde n’est qu’une simulation. Pour le prouver, il n’y a qu’une solution : remonter l’axe du temps.
En lisant La Mer de la tranquillité, difficile de ne pas penser à l’œuvre de David Mitchell et en particulier à son chef d’œuvre Cloud Atlas. Comme lui, Emily St. John Mandel multiplie les personnages, les lieux et les époques et trace des fils qui les relient de plus en plus fortement au fur et à mesure du roman. Néanmoins, la romancière choisit d’ancrer son récit dans le quotidien des personnages, en s’attardant sur de petits événements, sur de petits instants a priori insignifiants mais qui se chargent de sens à mesure que l’on approche du dénouement. Le grand talent d’Emily St John Mandel réside notamment dans cette capacité à rendre palpitant un récit composé d’une succession de petits faits, de petites scènes, tantôt banales, tantôt étranges. Et même si la dernière partie du livre voit le rythme s’accélérer, on est avant tout séduit par la douce mélancolie dans lequel baigne tout le récit.
L’autrice parvient en outre à aborder une multitude de thèmes (la colonisation, les pandémies, etc.), parmi lesquels une réflexion sur notre goût pour les récits postapocalyptiques. Elle nous offre également une passionnante réflexion métaphysique : si nous vivons dans une simulation, notre vie a-t-elle encore un sens ? Mérite-t-elle tout de même d’être vécue si tout ce qui nous entoure n’existe pas ?
Récit riche mais limpide, La Mer de la tranquillité s’inscrit en outre dans un projet littéraire d’une grande cohérence. Ainsi, et même si le roman est totalement autonome, on voit réapparaître ici des personnages déjà présents dans L’Hôtel de verre, un autre roman de la Canadienne. De même, comment ne pas voir en Olive Llewellyn, une alter-ego de l’autrice elle-même, le roman Marienbad ressemblant étrangement à Station Eleven ?
Bref, La Mer de la tranquillité confirme le talent d’une romancière sensible et singulière. Emily St. John Mandel s’empare une nouvelle fois d’un matériau bien connu des lecteurs, mais pour en proposer une variation aussi originale qu’intelligente.
![]()
Grégory Seyer
