Ne faisant pas dans la demi-mesure, se refusant à toute tiédeur, The Wall offre aux Pink Floyd leur dernier grand succès, avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie : il est une brique majeure de plus dans ce splendide mur qu’est leur discographie.
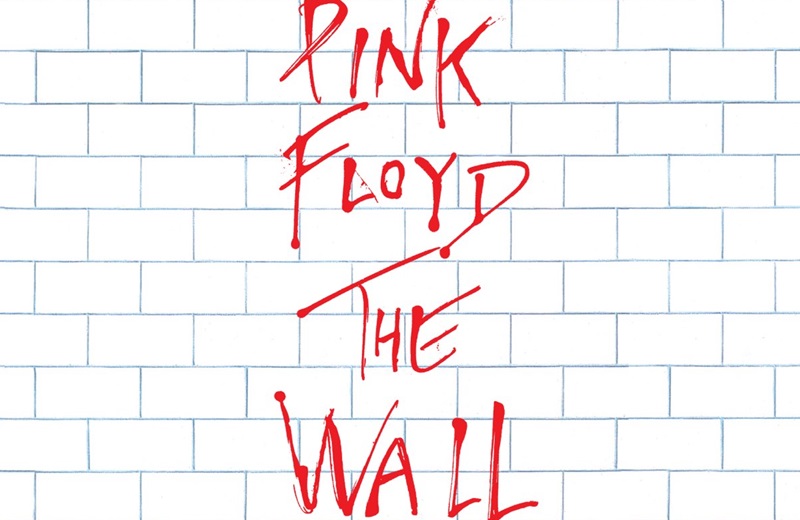
C’est Waters – et un peu Barrett – qui transpire par tous les pores de la peau de Pink. C’est ce musicien, cette Rock Star perdue dans les affres d’un star system cannibale et impersonnel, qui va doucement tomber dans la folie et l’aliénation des faux-semblants. Le traumatisme du spitting incident de Montréal est encore vivace dans la mémoire de Waters. Tellement vivace qu’il donnera au premier titre du disque, le nom de cette maudite tournée : In the Flesh? Les psychoses, les angoisses et les fantasmes de Roger/Pink s’étalent sans honte, froidement, presque cliniquement. L’absence du Père, d’abord, comme traumatisme primaire, primitif, fondateur de cet homme fracturé (In the Flesh?, Another Brick in the Wall, Part 1) devient la clé de voûte sur laquelle va s’ériger cet immense mur de frustrations et de distanciation émotionnelle.
 C’est encore l’enfance qui revient, cette enfance décisive, formatrice, déformatrice qui vient hanter les souvenirs de Roger/Pink. Un père absent, mort à la guerre et une mère protectrice (Mother, The Thin Ice, Goodbye Blue Sky), surprotectrice, castratrice, qui ne veut pas perdre cet enfant, ce souvenir de chair, seule chose que son aviateur de mari lui ait laissé avant de disparaître dans un charnier quelconque de la seconde guerre mondiale.
C’est encore l’enfance qui revient, cette enfance décisive, formatrice, déformatrice qui vient hanter les souvenirs de Roger/Pink. Un père absent, mort à la guerre et une mère protectrice (Mother, The Thin Ice, Goodbye Blue Sky), surprotectrice, castratrice, qui ne veut pas perdre cet enfant, ce souvenir de chair, seule chose que son aviateur de mari lui ait laissé avant de disparaître dans un charnier quelconque de la seconde guerre mondiale.
C’est ensuite l’éducation que Pink met en accusation. Cette école broyeuse d’individualités, destructrice d’originalité. Une prison-usine pour enfants, fabriquant du produit standardisé, de l’esprit calibré, de la chair à marier, de la viande à exploiter (The Happiest Days of Our Lives, Another Brick in the Wall, Part 2). « All in all, it’s just another brick in the wall ». Cette enfance traumatique est la grande pourvoyeuse de ces briques que Pink empile autour de lui. Ce mur de frustration et d’incommunicabilité qui monte inexorablement et l’enferme dans son aliénation, confit dans des névroses de plus en plus cannibales.
Devenu star du Rock connu et reconnu, Pink se marie. Loin de l’extraire de ces murs allégoriques, il continue « Brick by Brick » à façonner sa prison dorée (Empty Spaces). La vie de Rock Star reprend, déconnectée du réel, emportant Pink dans le tourbillon cocaïné des tournées interminables offrant aux appétits voraces de ces demi-dieux à cheveux longs les petits culs rebondis de groupies hystériques (Young Lust).
Mais la vie de tournée, les groupies offertes, appétissantes, la drogue qui fait tenir debout, qui fait avancer comme un zombi, en cognant les murs, dans les halls luxueux des hôtels du monde entier ne permet pas la vie de couple, cette stabilité réconfortante dont Pink aurait tant besoin. Sa femme est infidèle, il l’apprend. Tout s’écroule autour de lui, cette vie de couple virtuelle qui lui maintenait encore la tête hors de l’eau, ce fol espoir que tout ne soit pas pourri, qu’il reste encore un peu de pureté dans ce monde s’envole. Pink, camé jusqu’à la moelle, ramène de la chair fraiche bon marché prélevée devant la porte de sa loge. Une groupie tremblante d’excitation de passer la nuit avec son idole, une fan qui va vite déchanter à la vue de son idole en pleine crise de rage « Run to the bedroom, in the suitcase on the left. You’ll find my favorite axe. » qui finira par fuir à moitié nue dans la nuit glaciale (One of My Turns).
C’est l’appel déchirant d’un Pink abandonné de tous qui crie Don’t Leave Me Now à sa femme déjà loin, une montée en crescendo dans un falsetto à la limite du faux, la supplique poignante d’un Waters sur le fil qui culminera lors d’une acmé d’une tristesse infinie avec l’arrivée désespérée de la Black Strat de Gilmour qui vient porter ce petit bijou sombre et douloureux aux nues.
Le mur est désormais achevé. Tous ces traumatismes, ces angoisses existentielles, ces brimades et ces humiliations sont maintenant en place, bien rangés dans ce grand mur allégorique. L’isolement social et affectif est complet. Pink peut sombrer (Another Brick in the Wall, Part 3, Goodbye Cruel World ).
Ainsi s’achève dans le désespoir le plus sombre le premier disque de ce double album.
Le choix de l’Opéra-Rock vient mettre à mal les structures progressives patiemment mises en place par les Floyd durant des années. L’obligation d’une narration cohérente et condensée, les codes rigides de l’Opéra-Rock vont obliger les Pink Floyd – que dis-je ? Waters ! – à repenser leur musique. Les longs morceaux atmosphériques, inspirés et interminables ne sont plus de mise désormais. Le format des chansons se fait court, ramassé (Comfortably Numb, le plus long morceau de l’album, fait à peine 6:19 min). C’est l’ADN même du groupe qui est en train de muter. La nouvelle théâtralisation de la musique du Floyd implique une nouvelle approche, un nouveau logiciel. Là où la musique du groupe semblait en totale liberté, conquérante, créatrice de mondes et d’atmosphères il y a quelques années, c’est dorénavant la rigidité de la narration et le poids du concept qui pèse sur les épaules de l’ancien groupe de Space Rock. Le cadre est serré pour un groupe comme Pink Floyd qui avait cette habitude de dilater les morceaux, de prendre le temps de poser ses ambiances et de progresser par touches assez fines. C’est dorénavant dans l’immédiateté, dans ce premier degré que requiert la narration qu’ils vont devoir évoluer avec The Wall.
Si cette douce anarchie musicale d’un early-Pink Floyd semble déjà lointaine avec ces morceaux qui semblaient évoluer par eux-mêmes, roulant et grossissant sous leur propre poids, le Floyd reste tout de même le Floyd. La conception de The Wall, sa structure, sa propre rythmique, l’intelligence et le professionnalisme de la production vont amener ce récit monolithique sur les cimes du genre.
Les titres se raccourcissent, s’enchaînent. La cohérence de la narration est renforcée par une production qui vient alléger ce bloc de nihilisme en masquant les enchainements des titres, lissant les arêtes rugueuses des complexes liaisons entre les morceaux donnant ainsi une homogénéité discrète mais percutante entre les thèmes et les différentes textures de l’album. La structure complexe de l’album à laquelle s’attèlent les trois producteurs (Waters, Gilmour et Ezrin) est un véritable casse-tête. Car si les chansons restent bien cadrées dans la charpente étroite du disque, si les titres s’imbriquent dans un format plus court pour un souci évident de lisibilité, le vrai travail du groupe va être la création du liant, de l’uniformisation et de la cohérence de l’œuvre. Les Floyd vont alors travailler les thèmes, les gimmicks musicaux. Ces trames sonores qui vont agir comme des réminiscences dans l’esprit de Pink et de l’auditeur. Un sentiment de « déjà-vu » acoustique qui vient donner la chair au disque, qui vient modeler la glaise du narratif créant dans un même élan le personnage, ses traumas et sa chute dans la folie. Les motifs d’In the Flesh ou d’Another Brick in The Wall par exemple reviennent à différents moments de l’album fabriquant ainsi le souvenir, donnant ce supplément d’âme au personnage et accentuant l’effet d’un voyage intime dans une psyché d’abord vacillante, puis souffrante et finalement survivante. Les thèmes musicaux de l’album se chevauchent, se percutent, se déforment au fil de la chute de Pink intensifiant dans la distorsion d’un même motif, d’un même gimmick musical la sensation de perte de repères et de descente inéluctable dans les abîmes de la folie.
Les Floyd – et surtout Ezrin – vont rajouter de l’emphase à cette théâtralité déjà grandiloquente, appuyer là où ça fait mal et souligner au moyen d’un orchestre symphonique l’hyperbolisme de l’œuvre et de son auteur. L’Orchestre philharmonique de New York et du New York Symphony Orchestra, ainsi que le chœur du New York City Opera vont se mettre à l’oeuvre – sous la direction du grand Michael Kamen (compositeur des B.O de Brazil, Highlander, L’Arme fatale, Die Hard… ainsi que de nombreuses collaborations avec Bowie, Queen, Aerosmith ou Metallica) – et donner une outrance classique, une exubérance philharmonique mêlant modernité et classicisme à l’œuvre. Un mélange détonnant qu’avaient déjà expérimenté le Floyd quelques années plus tôt avec la première face d’Atom Heart Mother, mais cette fois-ci c’est dans le cadre rigoureux d’un narratif complexe et d’une obligation d’homogénéité musicale que la structure classique va devoir s’insérer. Avec Nobody Home ou Comfortably Numb notamment, à l’inverse d’AHM où l’utilisation de l’orchestre Classique et du groupe se suffisait à elle- même, l’architecture classique fusionne discrètement avec les compositions de Roger, laissant percer sous le vernis symphonique la pureté d’un hard rock parfaitement maîtrisé. Avec le point culminant de l’album – musicalement et narrativement – qu’est The Trial, l’orchestration classique se fait pompeuse, déclamatrice, dans une sorte d’opéra déjanté où l’outrance assumée et la théâtralité démesurée viennent terminer l’histoire de Pink dans une acmé épique, une apogée volontairement rococo.
Le mur est terminé. Pink est seul. Désespérément seul. La chute est terminée, l’atterrissage est épouvantable.
Cet isolement qu’il a souhaité, ces paradis artificiels dans lesquels il s’est perdu ne sont que mirages qui s’estompent quand la chimie ne fait plus effet. Il appelle, mais il n’y a que sa voix qui résonne entre ces immenses murs de briques, personne ne répond (Hey You). Cloitré dans sa chambre d’hôtel, ses suppliques ne parviennent pas à l’extérieur du mur (Is There Anybody Out There?), il est seul avec ses biens, son matérialisme imbécile, son pognon inutile, avec ses bibelots inertes et ses souvenirs douloureux (Nobody Home). Ce sont les oripeaux vieillis de la seconde guerre mondiale qui viennent hanter Pink dans un délire hallucinatoire où les chœurs grandiloquents de l’Opéra de New York hurlent de ramener les soldats chez eux (Bring the Boys Back Home).
C’est évanoui, drogué jusqu’à la moelle, les yeux révulsés et la bave aux lèvres que ses roadies retrouvent Pink après avoir démoli la porte de sa loge. Les sirènes de l’ambulance se mettent alors à hurler emportant l’artiste comateux. Mais il faut continuer, il faut faire tourner la machine à fric, donner de la bouffe aux piranhas, de la présence scénique aux fans. On lui administre une drogue, une de plus, une seringue de plus, pour réveiller le mort, permettre le énième soubresaut de cette machine fatiguée. C’est « confortablement engourdi » au fond de cette ambulance hurlante, l’âme flottant mollement au dessus de sa carcasse émaciée que va démarrer ce titre – en « autonomie » (ne découlant pas ou ne se fondant pas dans le morceau qui le précède ou le suit) au sein de l’album – qui va au même titre que Another Brick in the Wall, Part 2 devenir immédiatement culte. Cette plongée musicale dans la surdose stupéfiante, cette autopsie de l’overdose et de l’inertie médicamenteuse va permettre à David Gilmour d’offrir un des plus beaux solos de guitare de tout les temps (qui prendra encore plus d’ampleur lors des live du groupe). La structure de l’Opera Rock, ses morceaux plus courts, son obligation narrative ont quelque peu paralysé les longues envolées atmosphériques du génie de la Strat’, mais le maître va se venger. Gilmour va emporter un morceau facile, un brin paresseux, vers les plus hautes cimes du solo Rock. Gilmour comme une piqûre d’adrénaline sur un moribond vient réanimer le titre et l’auditeur emportant dans un tourbillon d’émotions, un florilège de notes choisies par les dieux où la rugosité d’une saturation superbement compressée vient griffer le toucher de velours de David, portant les bends légendaires du guitariste au panthéon de la guitare rock. Cette main de fer dans un gant de velours continue d’écrire la légende du Floyd. N’en déplaise à Roger.
Gilmour comme témoin de cette bascule qui fit passer la maîtrise du son, la maturité musicale de Pink Floyd à la paranoïa, à la triste mégalomanie d’un Waters seul au monde.
La drogue semble agir, Pink se relève comme il peut, titubant sous les applaudissements intéressés des managers et promoteurs, ces sangsues à pognon qui le jette sur scène comme on balance un quartier de barbaque aux requins (The Show Must Go On). Pink est sur scène, debout, chancelant, aveuglé par les projecteurs et enivré par les clameurs d’un public avide de spectacle. Mais le cocktail détonant stress, peur et médicaments va déclencher une rage hallucinatoire, un délire paranoïaque et schizophrénique où Pink se métamorphose en dictateur fasciste, en Hitler de pacotille. L’artiste va alors se lancer dans de violentes diatribes racistes et xénophobes, organisant dans sa folie destructrice : pogroms et chasse à l’homme de couleur dans la banlieue londonienne (la folle trilogie : In the Flesh, Run Like Hell et Waiting for the Worms ).
Stop ! C’est le cri du réveil, de la longue descente stupéfiante, d’un trop lent retour à la normale. Une lente descente qui va amener Pink à se faire son propre procès (The Trial), un procès baroque et terrifiant. Une audience cauchemardesque où se succède dans un opéra halluciné sa mère surprotectrice et castratrice, sa femme sous la forme d’une hideuse mante religieuse, le tout ponctué par les sentences idiotes et irrévocables d’un juge représenté par un énorme cul crachant ses verdicts et sa morale publique par son anus et intimant l’ordre dans une éjaculation merdeuse de faire abattre ce putain de mur.
« Tear down the wall ! » Abattez ce mur ! scandé par des centaines de voix, ces voix féroces qui cognent, qui résonnent à travers la carcasse décharnée de Pink, comme les traumas, les peurs, comme les humiliations subies et perpétrées, comme les addictions mortifères et les blessures d’orgueil qui jaillissent hors de lui comme le pus gicle d’un abcès trop mûr. « Tear down the wall ! Tear down the wall ! Tear down the wall ! » Les briques se fissurent, le soleil pénètre enfin par les interstices, le mur s’effondre et la lumière jaillit. Pink est libre à nouveau (Outside the Wall).
Pink s’est enfin libéré de ses chaînes, il a avalé et digéré ses traumatismes, mis à bas ce mur, cette barricade mentale qui l’isolait du monde. Waters n’en a pas fait de même. Là où il offrait guérison et résurrection pour son héros, Roger, lui, s’enfonce dans l’isolement au sein de son propre groupe, de sa propre œuvre. La rémission qu’il accordait à Pink, il ne pourra se l’octroyer. Autant décrié qu’admiré, sommet d’orgueil et d’arrogance pour les uns, réussite absolue d’un Rock lyrique, sombre et racé pour les autres. The Wall ne laisse pas l’auditeur indemne. Il irrite, il émerveille. Il fascine, il énerve. Alors que reste t-il de l’album ? Chacun sera juge : boursouflure égotique ou sommet du concept album progressif ? L’album, à l’image de son auteur, ne fait pas dans la demi-mesure, se refusant à toute tiédeur, il offre aux Pink Floyd leur dernier grand succès (avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie, il est également le double album le plus vendu au monde) et une brique majeure de plus dans ce splendide mur qu’est leur discographie.
Renaud ZBN

Je souligne toujours que les jérémiades de Gilmour ne sont arrivées qu’après, quand Waters a mis un point final au groupe parce qu’il était LE SEUL à continuer à travailler.
Après la tournée Animals et quelques mois de pause, quand le groupe se trouve pour bosser sur la suite, Roger arrive avec, sous le bras, deux albums déjà pré-maquettés à la maison. Le premier sera The Wall, prévu pour être un quadruple album et le second deviendra The Pros and Cons… son album solo.
Dans les séances d’enregistrement, Wright est tellement sous héroïne qu’il est incapable de jouer et, plutôt que de retenter l’expérience déjà vécue avec Barrett, Waters le vire pour qu’il aille se soigner.
Au delà des qualificatifs d’égotique ou je ne sais quoi, regardons les faits : Waters faisait avancer Pink Floyd, amenant de la matière, des idées et des concepts pendant que le reste du groupe, dont Gilmour, se contentaient de compter les royalties.
Je n’ai pas les éléments pour argumenter avec toi, mais cette version me semble en effet très probable. Merci d’apporter cet éclairage au débat. Et au plaisir de te lire à nouveau. Je laisserai aussi notre rédacteur te répondre éventuellement s’il veut ajouter quelque chose.
Eric
Je suis effectivement d’accord avec toi.
La mégalomanie de Roger a fait exploser PF mais lui a permis après DSOTM, où les esprits étaient fatigués et le groupe vidé, de se régénérer.
C’est lui le créateur de concept, des titres, du visuel. Il a permis au Floyd d’exister une petite dizaine d’années de plus et de lâcher une paire d’albums culte, ce qui n’était pas gagné.
écorché et complexe, odieux et visionnaire, un sacré bonhomme le Roger tout de même
Relis un peu l’histoire du Pink Floyd, tu comprendras mieux ce qu’il s’est passé dans la vie du groupe. Vas dire tout ce que tu écris sur Gilmour à ses fans et ils te répondront que sans Waters, Gilmour, Mason, Wright, Pink Floyd n’existerait pas. Sid est mort depuis longtemps, lui aussi à aidé le groupe à ce monter et à devenir ce qu’il a été au moment du Mur. The Wall sans la guitare de David ce n’est pas the Wall, Waters n’a pas fait le boulot tout seul…
n’importe quoi !!! vous avez jamais écouté Ponk Floyd il me semble, les solos de Gilmour ça vous dit rien ?3dernoers albums de Pink Floyd vous y êtes au courant ?
n’importe quoi !!! vous avez jamais écouté Ponk Floyd il me semble, les solos de Gilmour ça vous dit rien ?3dernoers albums de Pink Floyd vous y êtes au courant ?
Superbe article ! Impressionnant de justesse et de précision, bravo et merci ! Pour ma part, je n’arrive pas à prendre parti dans la gueguerre entre Roger et David, et aussi Rick et Nick ; leurs contributions respectives me paraissent aussi différentes que complémentaires. S’il existe une structure commune entre les différents albums de PF c’est bien cette alternance de folie, de chaos puis d’harmonie, de rédemption.. mais il y a quand même effectivement un pblm avec Roger aujourd’hui quand on le voit défendre la position de Vladimir à l’Onu… et traiter Joe de dictateur… c’est juste… dommage !
Merci pour ton commentaire Eric…
Cette alchimie étrange et improbable entre le feu Waters et la glace Gilmour fait le sel des Floyd et leur a permis d’atteindre les sommets.
D’accord avec toi sur cette complémentarité qui leur a permis, malgré une technique peut-être en dessous des King Crimson, Genesis ou Yes, de graver leur nom tout en haut du Panthéon Rock
depuis le temps que j’écoute The Wall, jamais je n’avais réalisé quel était le sous texte, le livret de cet opéra. j’ai dévoré avidement cet article, merci !
Merci pour ton gentil commentaire Nico…
Il est vrai que la chronique est bien faite et m’a donné, du coup, envie de réécouter cette oeuvre dont je m’étais quelque peu lassé, il y a quelques temps déjà…
Merci de ton commentaire Eric TR…