Avec Hallyuwood, Le Cinéma Coréen, Bastian Meiresonne offre un panorama complet du cinéma coréen en français mettant en relation son présent et son passé.

Qu’il me soit permis, ne serait-ce que pour éclairer les qualités du travail de Bastian Meiresonne, d’évoquer ma propre découverte du cinéma coréen au début des années 2000. Une découverte qui passa en premier lieu par les salles au travers de l’odeur de soufre du cinéma de Kim Ki-duk, du statut de figure emblématique du cinéma de Corée du Sud d’un Im Kwon-taek, des édifices théoriques autour du marivaudage de Hong Sang-soo et du sens romanesque d’un Lee Chang-dong. En salles encore, des rétrospectives allaient permettre de tenter de faire un lien entre le cinéma coréen contemporain et son passé. Le DVD à l’import permettait aussi de découvrir les classiques coréens des années 1960.
Mais surtout les derniers gros succès au Box Office local, non parfois sans déconvenues. Parmi les découvertes, un JSA (Joint Security Area), blockbuster humaniste sur une nation coupée en deux, qui commença à imposer le nom de Park Chan-wook aux cinéphiles férus d’Asie. Et une semaine de fin novembre 2003 compta fortement me concernant, celle de l’arrivée en import de Memories of murder. Réservé sur la seule foi de son casting (Kim Sang-kyung vu chez Hong Sang-soo, Song Kang-ho déjà acteur phare du cinéma populaire du matin calme) et de son statut momentané de « plus gros succès de l’histoire du cinéma coréen ». Je tenais enfin un film de genre coréen soutenant la comparaison avec les grands films de genre hongkongais et nippons des années 1990.

Ce versant-là du cinéma coréen allait de plus en plus être distribué en France et investir les grands festivals : coup de tonnerre du Grand Prix cannois d’Old Boy en 2004, passage progressif d’un Bong Joon-ho des sections parallèles cannoises à la compétition officielle jusqu’à la consécration suprême Parasite. Mais l’installation de la Corée du Sud sur la mappemonde de la culture populaire durant la période ne se limita pas au cinéma. Elle passa énormément par les séries (les Dramas) et la K Pop (Psy, BTS). Qui d’ailleurs auront droit à leur mention légitime dans le livre.
Justement, avec comme titre de son livre Hallyuwood, Le Cinéma Coréen, l’auteur se place délibérément dans cette perspective : Hallyu, c’est le développement du soft power coréen dans le monde au travers des domaines artistiques mentionnés. Et qui dit soft power dit politique. Le rôle de l’Etat pour faire face à la fin des années 1990 à la domination des blockbusters hollywoodiens est bien connu. On se doutait aussi que les tumultes de l’histoire du pays dans la seconde moitié du 20ème siècle avaient forcément impacté son industrie cinématographique.
Le livre formalise ce lien puissant entre le politique et la destinée du cinéma local. Le cinéma subit les variations de la censure, les changements politiques quand il n’est pas délibérément pensé comme outil de propagande. La stratégie politique de soutien au cinéma de la fin des années 1990 passe autant par les subventions, une volonté de priorité accordée dans les salles à l’exploitation du cinéma national et une stratégie promotionnelle offensive à l’export. Une volonté étatique pas incompatible avec l’implication des grandes entreprises coréennes dans le cinéma local.
L’autre intérêt réside dans la mise en exergue des liens thématiques, esthétiques et d’inspiration entre le cinéma coréen de la seconde moitié du 20ème siècle et le cinéma coréen actuel. La part de nationalisme des blockbusters des années 2000 n’est pas sans lien avec le nationalisme de quelques œuvres historiquement importantes du cinéma coréens. De son côté, un Kim Ki-young serait l’équivalent coréen d’un cinéaste de Série B culte à l’influence très présente dans le cinéma de genre contemporain. Les ruptures de tons de son classique La Servante annoncent celles du trio Park Chan-wook/Kim Jee-woon/Bong Joon-ho qui le cite en référence. Et l’idée de la résidence cossue du film matérialisant les fractures de classes de la société coréenne sera directement reprise dans Parasite.
La manière dont le cinéma coréen se nourrit d’influences étrangères ne date pas non plus de la vague des cinéastes cinéphiles incarnée par le trio mentionné. Le films découverts par des cinéastes des années 1960 en voyage au Japon irriguèrent le cinéma coréen de la période Et dans la foulée du Japon à la même époque le cinéma coréen eut sa vague de films Rebel without a cause. S’il faut chercher une ascendance au Bon, la Brute et le Cinglé c’est moins du côté de Leone que des tentatives locales passées de démarquages du western spaghetti. Les romcoms de guerre des sexes des années 2000, parmi lesquelles le hit My Sassy Girl, surgirent quant à elles en réaction au classique américain du genre Quand Harry rencontre Sally. Et le cinéma de genre coréen a fini par faire parler de lui à l’international au travers d’un genre peu abordé en Asie : le film de zombies (Dernier Train pour Busan).

Le livre s’achève par un constat nuancé de la situation actuelle de ce cinéma. Les 10 millions d’entrées sont certes moins facilement atteintes en salles à domicile par un film coréen depuis le COVID et l’émergence de Netflix. Mais, si les plateformes représentent en apparence une menace, le cinéma sur plateforme pourrait incarner une manière de faire sa place sur le marché américain plus efficace que les voies classiques de diffusion. Plateformes qui ont déjà renforcé le soft power coréen des séries (cf. Squid Game).
Si le livre aborde très bien divers aspects du cinéma coréen (économie, esthétique, politique, reflet sociétal, rapport avec l’histoire…) il pourrait lui être reproché de faire peu de cas d’un élément important du cinéma coréen post-1998 : le rôle des chefs-opérateurs ayant souvent étudié aux States. Ces derniers sont en effet en partie responsables de la finition technique ayant rendu ce cinéma-là aisément exportable.
Reste quand même un bel objet, superbement illustré, un beau résumé en français de l’histoire du développement d’une cinématographie ayant joué les premiers rôles en Asie ces 20 dernières années.
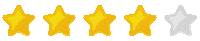
Ordell Robbie
