Un espion en Canaan est une parabole sur la possibilité qui nous sera toujours offerte de faire le bien, de sauver celles et ceux qu’on peut sauver. Il suffit (seulement) de ne pas manquer les occasions offertes. Un style superbe, une écriture racée pour une histoire violente, et pleine d’humanité. Une preuve de plus que David Park est un grand écrivain.

Le Livre des Nombres, la partie de la Bible qui raconte l’histoire du peuple d’Israël entre la fuite d’Égypte et l’arrivée en terre promise, raconte que Dieu, qui voulait donner le pays de Canaan aux Israélites pour qu’ils s’y installassent, demanda à Moïse d’envoyer 1 représentant de chacune des 12 tribus d’Israël explorer cette terre. 10 des 12 « espions » revinrent déçus et désabusés. Ce que leur proposait Dieu n’avait aucun sens. cette contrée n’était pas pour eux ; les Cananéens étaient trop grands pour qu’ils soient vaincus, et leurs villes trop fortifiées pour être prises. 2 en revanche – 2 seulement – revinrent persuadés que ce pays était fait pour eux et, qu’avec l’aide de Dieu, leur installation dans ce pays de cocagne serait possible. Et Dieu, pour punir ceux qui avaient douté, décida d’envoyer les tribus d’Israël errer dans le désert pendant 40 ans, et y mourir…
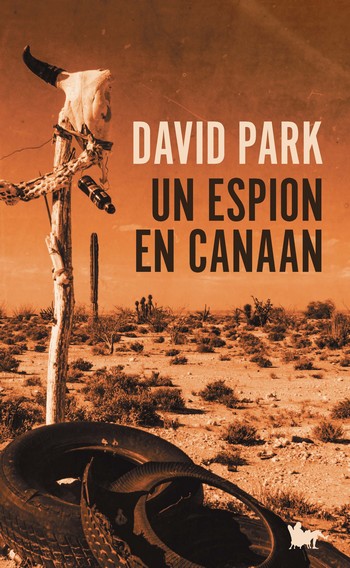 La parabole biblique est bien présente dans le livre de David Park – même s’il est toujours possible de le lire sans s’y référer comme un roman sur les limites et les vertus de l’humanité. David Park la cite fréquemment. Le titre, évidemment, est clair. Le nombre aussi. Car ils sont bien 2 ceux qui, parmi tous les « espions » envoyés dans le vaste monde, 2 qui ne doutent pas, et qui croient qu’il est possible de réussir à un moment ou à un autre à remplir sa mission, à faire le bien. Un peu comme si Canaan était ce pays de cocagne que les États-Unis d’Amérique sont pour un grand nombre de réfugiés, et qu’il était du devoir de certains espions de permettre son accès au plus grand nombre. L’espion comme sauveur de son peuple. À condition de le vouloir…
La parabole biblique est bien présente dans le livre de David Park – même s’il est toujours possible de le lire sans s’y référer comme un roman sur les limites et les vertus de l’humanité. David Park la cite fréquemment. Le titre, évidemment, est clair. Le nombre aussi. Car ils sont bien 2 ceux qui, parmi tous les « espions » envoyés dans le vaste monde, 2 qui ne doutent pas, et qui croient qu’il est possible de réussir à un moment ou à un autre à remplir sa mission, à faire le bien. Un peu comme si Canaan était ce pays de cocagne que les États-Unis d’Amérique sont pour un grand nombre de réfugiés, et qu’il était du devoir de certains espions de permettre son accès au plus grand nombre. L’espion comme sauveur de son peuple. À condition de le vouloir…
Car faire le bien n’est pas si facile, comme s’en rendent compte Michael Miller, un presbytérien, et Ignatius Donovan, un catholique, les deux personnages clés de ce roman. D’autant moins qu’ils ne sont eux-mêmes pas des saints. Ils ont leurs faiblesses, leur part d’ombre, d’humanité, qui les fait hésiter, errer, se tromper. Mais l’histoire repasse les plats. En tout cas, elle nous donne l’occasion de se racheter, même si c’est à plusieurs décennies d’intervalle. Il suffit de ne pas louper le second service. C’est peut-être le message de ce roman (l’un d’entre eux, en tout cas) : l’erreur est possible, humaine, mais si se présente à vous une nouvelle route qui vous remet dans la bonne direction, il faut la prendre.
C’est donc ce qui arrive à Michael Miller et Ignatius Donovan – le titre original du roman de David Park est au pluriel, Spies in Canaan, ce qui paraît plus adapté que le titre au singulier de la version française. Nous sommes en 1973, le jeune Michael Miller débarque à Saïgon de son Midwest natal pour travailler à l’ambassade Américaine. La guerre du Vietnam est bientôt terminée et l’employé de bureau Michael Miller n’a pas grand-chose à faire que d’accompagner la débâcle. Et peut-être aider en retour celles et ceux qui avaient choisi d’aider les américains. Il en a l’opportunité quand Ignatius Donovan, un peu plus ancien dans le métier et depuis plus longtemps au Vietnam, l’embauche pour travailler pour lui et recueillir des informations sur le conflit. Mais Michael Miller est trop jeune, trop inexpérimenté, et Ignatius Donovan trop cynique, pour faire ce qu’il faut. Une inaction qui pèsera sur leur conscience pendant des années. Si bien qu’au moment où ils auront la possibilité de revenir sur cette erreur, ils le feront, prendront les risques qu’il faut. Faire le bien, une dernière fois, au crépuscule de leur existence. Quoi qu’il en coûte. Et dans ce monde de violence, de haine et de sang, le coût n’est pas si petit.
David Park parle un peu de haine, de violence et de sang. Il raconte ce monde, dans lequel les mêmes conflits se répètent, créant encore et toujours les mêmes drames. Mais il parle aussi (et surtout) de ce que chacun peut faire, à titre individuel, pour changer tout cela. Il parle plus d’humanité, que d’inhumanité ; plus de bonté d’âme, que de cynisme ; plus de solutions que de problèmes. Et il parle de la culpabilité – parfaitement judéo-chrétienne – que l’on peut ressentir à ne pas faire le bien quand on en a la possibilité. Il parle aussi de la difficulté de faire face au monde, de se glisser dans la peau d’un adulte responsable (ou d’assumer des responsabilités d’être humain). Mais il nous parle aussi de la possibilité de dépasser, finalement, cette difficulté. Et tout cela avec un style remarquable, dans une traduction superbe ; une écriture sophistiquée et subtile qui fait avancer le roman sur un rythme lent, mais majestueux, sans hâte et avec certitude. Un roman ample et puissant comme un fleuve.
![]()
