Si à peu près tout le monde s’accorde sur le fait que le premier album du Velvet Underground est l’un des plus impressionnants monuments (tagué copieusement, le monument) de la musique du XXème siècle, impossible de cacher que le second album, White Light/White Heat est celui que l’on préfère.

Je vais sacrifier au rituel, parce que, quelque part, le Velvet Underground, c’est quand un même avant tout un rituel : on va commencer par parler de Lester Bangs, le fameux Rock Critic qui prétendait juger du bon goût d’une personne en regardant l’état de la pochette de son exemplaire de White Light/White Heat (cela présupposait que la personne en détenait un, mais il est certainement inconcevable, en effet, de ne pas posséder ce monstre noir dans sa discothèque, on est bien d’accord). Si la pochette n’était pas usée, blanchie aux coins, la personne n’avait certainement pas assez écouté le second album du Velvet, et ses goûts musicaux étaient pour le moins questionnables.
 Parce que ce texte n’a rien d’une critique de disque, je vais ajouter deux brèves anecdotes personnelles. En 1971, alors que je venais de découvrir le Velvet Underground, j’avais apporté ce disque au foyer des élèves de mon lycée, où il y avait un électrophone, généreusement offert par l’administration : je n’ai jamais vu la pièce se vider aussi rapidement de ses occupants, et j’ai acquis du coup la réputation d’un dangereux maniaque. (Bon, l’honnêteté me pousse à avouer que j’ai fait pire en 1977 en tirant des coups de fusil de chasse – à blanc, à blanc ! – dans les portes de ma résidence universitaire après que les voisins aient protesté parce que j’écoutais trop fort les Sex Pistols… mais c’est une autre histoire…).
Parce que ce texte n’a rien d’une critique de disque, je vais ajouter deux brèves anecdotes personnelles. En 1971, alors que je venais de découvrir le Velvet Underground, j’avais apporté ce disque au foyer des élèves de mon lycée, où il y avait un électrophone, généreusement offert par l’administration : je n’ai jamais vu la pièce se vider aussi rapidement de ses occupants, et j’ai acquis du coup la réputation d’un dangereux maniaque. (Bon, l’honnêteté me pousse à avouer que j’ai fait pire en 1977 en tirant des coups de fusil de chasse – à blanc, à blanc ! – dans les portes de ma résidence universitaire après que les voisins aient protesté parce que j’écoutais trop fort les Sex Pistols… mais c’est une autre histoire…).
Flashforward en septembre 2019 : je suis au concert de Mattiel à la Maro, et la jeune femme termine son concert par une reprise saignante de White Light/White Heat qui me met dans tous mes états. Je regarde autour de moi, et je suis stupéfait de réaliser que l’immense majorité du public n’a visiblement aucune idée de ce qu’est cette chanson. Mon cœur sombre comme une pierre : alors que le Velvet est probablement devenu, avec le recul, le groupe le plus influent de l’histoire du Rock, celui qui a défini les contours de le meilleure musique des quarante dernières années, plus personne n’a l’air d’avoir entendu White Light/White Heat. Heureusement que Lester est mort en 1982 !
 Je n’ai pas particulièrement envie de parler de la genèse de cet album, qui succéda très vite au premier : en registré « live en studio », sans aucune retenue et sans assez de maîtrise technique pour capturer l’essence d’excellentes nouvelles chansons qui sombrèrent dans le chaos, le second album du groupe fut un désastre commercial (un non-événement absolu), et précipita la rupture entre Lou Reed et John Cale. Lou, on le sait, voulait le succès et la reconnaissance, alors que Cale ne savait pas ce qu’il voulait, à part repousser les limites de la musique. Les musiciens jouèrent le plus fort possible, le producteur (Tom Wilson) n’en avait rien à battre, les ingénieurs du son, terrorisés, essayaient de baisser le volume chaque fois qu’ils le pouvaient : tous les éléments du chaos étaient présents pour que l’album soit un ratage. Or, même s’il n’est pas d’un abord facile, quelques écoutes en révèlent la sombre beauté. Plus tard, bien plus tard, dans un célèbre interview donné aux Inrockuptibles naissants, John Cale reconnaîtra ses erreurs, qui conduiront à son éviction du groupe, mais confirmera que le Velvet était devenu en 1968 un formidable groupe de scène, cherchant à trouver en live une puissance nouvelle, prolongeant ses morceaux pour en extraire une violence et un beat radicaux : entre la possibilité de jouer ces chansons avec grâce pour pondre un nouveau single comme Sunday Morning et la recherche de l’expérience sonore extrême, le Velvet avait choisi. Le résultat tua quasiment le groupe, mais nous donna un album inoubliable.
Je n’ai pas particulièrement envie de parler de la genèse de cet album, qui succéda très vite au premier : en registré « live en studio », sans aucune retenue et sans assez de maîtrise technique pour capturer l’essence d’excellentes nouvelles chansons qui sombrèrent dans le chaos, le second album du groupe fut un désastre commercial (un non-événement absolu), et précipita la rupture entre Lou Reed et John Cale. Lou, on le sait, voulait le succès et la reconnaissance, alors que Cale ne savait pas ce qu’il voulait, à part repousser les limites de la musique. Les musiciens jouèrent le plus fort possible, le producteur (Tom Wilson) n’en avait rien à battre, les ingénieurs du son, terrorisés, essayaient de baisser le volume chaque fois qu’ils le pouvaient : tous les éléments du chaos étaient présents pour que l’album soit un ratage. Or, même s’il n’est pas d’un abord facile, quelques écoutes en révèlent la sombre beauté. Plus tard, bien plus tard, dans un célèbre interview donné aux Inrockuptibles naissants, John Cale reconnaîtra ses erreurs, qui conduiront à son éviction du groupe, mais confirmera que le Velvet était devenu en 1968 un formidable groupe de scène, cherchant à trouver en live une puissance nouvelle, prolongeant ses morceaux pour en extraire une violence et un beat radicaux : entre la possibilité de jouer ces chansons avec grâce pour pondre un nouveau single comme Sunday Morning et la recherche de l’expérience sonore extrême, le Velvet avait choisi. Le résultat tua quasiment le groupe, mais nous donna un album inoubliable.
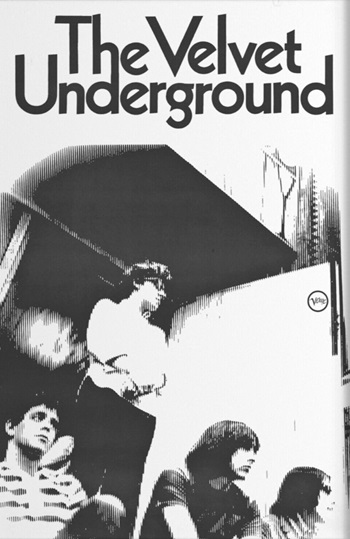 Au cœur de l’album, il y a bien entendu Sister Ray, sur la face B, une odyssée sonique qui peut venir à bout des oreilles les plus sensibles, et qui est à peu près inégalable. Injouable même, comme les jeunots de Joy Division (un autre groupe majeur pourtant) s’en sont rendu compte dix ans plus tard : leur version est belle parce qu’elle exsude une nostalgie douloureuse pour ce chaos intégral, npn reproductible, qu’est la chanson originale. Une grande partie de la musique « noisy », du krautrock aussi sans doute, est née de Sister Ray, et c’est un héritage colossal.
Au cœur de l’album, il y a bien entendu Sister Ray, sur la face B, une odyssée sonique qui peut venir à bout des oreilles les plus sensibles, et qui est à peu près inégalable. Injouable même, comme les jeunots de Joy Division (un autre groupe majeur pourtant) s’en sont rendu compte dix ans plus tard : leur version est belle parce qu’elle exsude une nostalgie douloureuse pour ce chaos intégral, npn reproductible, qu’est la chanson originale. Une grande partie de la musique « noisy », du krautrock aussi sans doute, est née de Sister Ray, et c’est un héritage colossal.
Mais l’arbre Sister Ray ne doit pas dissimuler le reste de la forêt, car White Light/White Heat ne compte aucun titre faible, même si la variété assez démentielle des styles musicaux et des atmosphères désarçonne a priori. Personnellement, plutôt que par les plus célèbres poursuites de la veine bruitiste du premier album, avec leurs déchirures électriques et leur déséquilibre sonique malaisant, j’avais été marqué à l’époque par le versant plus avant-gardiste du disque – celui de John Cale, donc – avec cette volonté inédite de raconter des histoires troublantes, effrayantes même, et de les poser sur un lit de sons hypnotiques, minimalistes à l’occasion (The Gift, Lady Godiva’s Operation). Je crois bien que comprendre ce que racontait ces morceaux fut à l’époque ma plus grande motivation pour perfectionner mon anglais (acquis en écoutant les chansons des Beatles), et m’envoya dans un Londres en pleine Bowiemania (mais c’est là aussi une autre histoire, même si, quelque part, tout ça fait sens…).
En réécoutant White Light/White Heat aujourd’hui, je suis surpris par les accents jazz, voire free jazz de certains passages (I Heard Her call My Name, une évidence). Et par la beauté tremblante de Here She Comes Now, un titre qui me paraissait anecdotique à l’époque, mais qui annonce le virage du troisième album vers d’autres types de splendeurs.
J’en ai assez dit : je vous laisse extraire la galette de vinyle de sa pochette (pas assez usée, à mon goût non plus) et poser White Light/White Heat sur votre platine. Mettez votre casque, tourner le bouton du volume sonore au maximum que vous puissiez supporter, et embarquez-vous dans le trip musical ultime. A l’époque, WL/WH était considéré comme LE disque de célébration de la drogue : on sait aujourd’hui que c’est un contresens absolu : C’EST CETTE MUSIQUE QUI EST LA DROGUE.
PS : Ah, et dites bonjour de ma part au fantôme de Lester quand il s’assiéra, souriant, à côté de vous.
![]()
Eric Debarnot
