Première collaboration avec Leonardo DiCaprio, Gangs of New York est un projet ancien dont la concrétisation se révèlera coûteuse à plus d’un titre. Heureusement, Scorsese peut compter sur la force de sa vision, qui demeure puissante en dépit d’une production dont les affrontements ne furent pas tous filmés.

Et paf ! Revoilà Martin Scorsese avec un bouquin ! Cette fois-ci, il s’agit de The Gangs of New York, ouvrage documentaire écrit en 1928 par Herbert Asbury. L’auteur s’intéresse aux guerres de gangs dans la Grosse Pomme du dix-neuvième siècle, avant que la ville ne tombe aux mains de la mafia italo-américaine. L’économie locale est alors un réseau de tripots, saloons et autres maisons de jeux, où évoluent des assassins aux sobriquets plus grands que nature, comme Bill le Boucher ou Maggie la Chatte des Enfers. Les luttes entre nativistes et immigrants font rage, pour départager le capital d’un Nouveau Monde dont la sauvagerie est désormais urbaine.
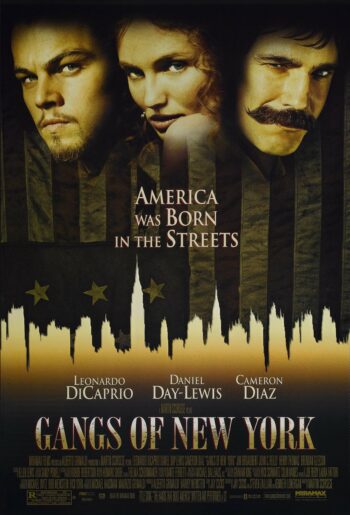 Pour Scorsese, issu du vivier catholique de Little Italy, ce genre de récit relève quasiment du mythe fondateur. À l’époque mise en scène par le film, le quartier général de l’immigration irlandaise n’est autre que la cathédrale St Patrick, ensuite transformée en une église fréquentée par la famille du petit Marty dans les années 50. Durant ses jeunes années, Scorsese remarque que certains éléments du paysage sont anciens, datés d’une époque où s’affrontaient nativistes et immigrés. Cette prise de conscience de l’existence d’une période antérieure à son propre milieu social le prédispose à en tirer un film. Découvrant le texte d’Asbury en 1970, il décèle instantanément le potentiel d’une trame de western. Une histoire de vengeance, celle d’un fils décidé à rendre justice à son père, assassiné par un hors-la-loi sanguinaire. Cependant, en 1970, le réalisateur n’est encore qu’au début de sa carrière. Il finit par acquérir les droits du livre en 1979 mais la production du film s’enlise immédiatement. Le projet nécessite des décors dantesques, New York a trop changé pour jouer son propre rôle et il est trop coûteux de chercher une ville de remplacement.
Pour Scorsese, issu du vivier catholique de Little Italy, ce genre de récit relève quasiment du mythe fondateur. À l’époque mise en scène par le film, le quartier général de l’immigration irlandaise n’est autre que la cathédrale St Patrick, ensuite transformée en une église fréquentée par la famille du petit Marty dans les années 50. Durant ses jeunes années, Scorsese remarque que certains éléments du paysage sont anciens, datés d’une époque où s’affrontaient nativistes et immigrés. Cette prise de conscience de l’existence d’une période antérieure à son propre milieu social le prédispose à en tirer un film. Découvrant le texte d’Asbury en 1970, il décèle instantanément le potentiel d’une trame de western. Une histoire de vengeance, celle d’un fils décidé à rendre justice à son père, assassiné par un hors-la-loi sanguinaire. Cependant, en 1970, le réalisateur n’est encore qu’au début de sa carrière. Il finit par acquérir les droits du livre en 1979 mais la production du film s’enlise immédiatement. Le projet nécessite des décors dantesques, New York a trop changé pour jouer son propre rôle et il est trop coûteux de chercher une ville de remplacement.
En 1991, le projet est proposé à Universal, qui passe son tour et refile le bébé à Disney. La souris refuse catégoriquement de financer une violence jugée gratuite. Warner Bros n’est pas intéressé. Idem pour la Fox, la Paramount et la MGM. C’est finalement le casting de DiCaprio, rendu ultra-bankable par Titanic, qui décide Miramax à financer l’entreprise. Il en résulte un budget multiplié (les 30 millions de dollars initiaux finiront par dépasser la centaine, soit le plus gros portefeuille manié par Scorsese à ce point de sa filmographie), ainsi que de bons gros emmerdements de production. Le tournage dans les décors de la Cinecittà prend plusieurs mois, durant lesquels Scorsese doit affronter Harvey Weinstein. Ce dernier fourre continuellement son nez dans le script, qu’il souhaite rendre plus « commercial ». Jay Cocks est viré avant d’avoir terminé l’écriture et Hossein Amini est convoqué pour rustiner l’engin, sans être officiellement crédité pour son travail. La production prend fin en mars 2001 mais la sortie du film est retardée. Officiellement, c’est pour laisser le public américain se remettre du 11 septembre. Officieusement, c’est lié aux coupes exigées par Weinstein, qui insiste pour raccourcir les trois heures du premier montage.
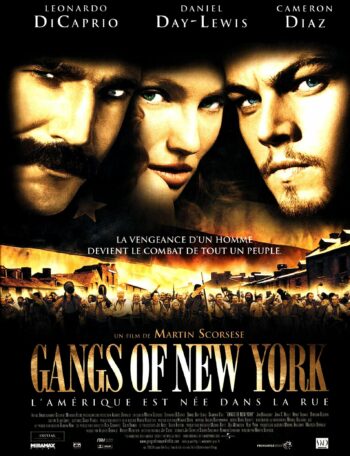 Avec une gestation si mouvementée, il va sans dire que Gangs of New York souffre de quelques imperfections. Or, le plus grand mérite du film est justement de faire valoir ses qualités bien plus que ses défauts. Côté casting, DiCaprio est compétent sans être transcendant ; et Cameron Diaz s’acquitte d’un rôle trop peu écrit pour lui permettre de briller. En revanche, la galerie de seconds rôles est d’une solidité invraisemblable. On croise ainsi Liam Neeson, Brendan Gleeson et Jim Broadbent, mais aussi John C. Reilly, Gary Lewis, Stephen Graham, Eddie Marsan, David Hemmings… et tout le monde s’avère très bon, quand bien même la pièce de résistance est servie par Daniel Day-Lewis, qui semble littéralement possédé par Bill le Boucher. L’idée de confier le rôle d’un leader nativiste à un comédien officiellement irlandais n’est pas qu’un pied de nez malin. La fameuse méthode immersive de Day-Lewis, mise au service d’un personnage de taré grandiloquent, a pour effet direct de produire un monstre de cinéma. Un carnassier de grand spectacle hollywoodien selon le canon classique du genre, assumant une caricature qui s’éloigne malicieusement des compositions « à Oscars » que le nom de Day-Lewis a parfois eu tendance à évoquer. Sa performance de danseur psychopathe, efflanqué et cabotin, fourbe et magnétique, en fait l’un des plus sublimes salopards de cinéma du nouveau millénaire.
Avec une gestation si mouvementée, il va sans dire que Gangs of New York souffre de quelques imperfections. Or, le plus grand mérite du film est justement de faire valoir ses qualités bien plus que ses défauts. Côté casting, DiCaprio est compétent sans être transcendant ; et Cameron Diaz s’acquitte d’un rôle trop peu écrit pour lui permettre de briller. En revanche, la galerie de seconds rôles est d’une solidité invraisemblable. On croise ainsi Liam Neeson, Brendan Gleeson et Jim Broadbent, mais aussi John C. Reilly, Gary Lewis, Stephen Graham, Eddie Marsan, David Hemmings… et tout le monde s’avère très bon, quand bien même la pièce de résistance est servie par Daniel Day-Lewis, qui semble littéralement possédé par Bill le Boucher. L’idée de confier le rôle d’un leader nativiste à un comédien officiellement irlandais n’est pas qu’un pied de nez malin. La fameuse méthode immersive de Day-Lewis, mise au service d’un personnage de taré grandiloquent, a pour effet direct de produire un monstre de cinéma. Un carnassier de grand spectacle hollywoodien selon le canon classique du genre, assumant une caricature qui s’éloigne malicieusement des compositions « à Oscars » que le nom de Day-Lewis a parfois eu tendance à évoquer. Sa performance de danseur psychopathe, efflanqué et cabotin, fourbe et magnétique, en fait l’un des plus sublimes salopards de cinéma du nouveau millénaire.
Il manque peut-être à Gangs of New York une fibre romantique qui, en contrebalançant l’outrance revendiquée du récit, aurait pu en faire un véritable chef-d’œuvre scorsesien. L’histoire d’amour entre le fils vengeur et la pickpockette peine à transporter le spectateur avec la même vigueur que les tableaux de violence urbaine. Lors de ces séquences, Scorsese semble proposer une révision, à la fois temporellement archaïque et techniquement actualisée, du filmage fiévreux des peignées de Mean Streets. Gangs of New York porte ouvertement la marque d’une double ambition, qui voudrait illustrer une page trouble de l’histoire américaine par des images mythologiques, tout en appâtant le grand public avide de fresques épiques. Or, même en franchissant la ligne d’arrivée dans une version racornie, le film impressionne par son rythme, son énergie et une maestria formelle qui rend largement compte de la ténacité de Scorsese. Face à une supervision invasive, il semble s’être vengé en dopant sa mise en scène pour mieux y faire jaillir sa vision du film, glissant une idée de cinéma dans chaque cadre, jouant sur les valeurs d’échelle pour servir la stylisisation d’une réalité reconstituée via ses fragments. Ironiquement, c’est aussi en étant charcuté par le Boucher Weinstein que Gangs of New York touche au cœur de son sujet, celui d’une démocratie baptisée dans la violence d’une civilisation hétéroclite, à qui New York continuera encore longtemps de confier ses méchantes rues. Aux dernières nouvelles, une adaptation en série serait dans les tuyaux. Affaire à suivre, donc, encore et toujours.
![]()
Mattias Frances
