Avec Houris, Kamel Daoud nous plonge dans la décennie noire qui a frappé son pays natal, l’Algérie, à travers le parcours d’un femme. Un roman d’une puissance d’évocation absolue, mais dans lequel le poids du symbole écrase le récit.

Kamel Daoud a choisi les mots contre le silence. Celui qui recouvre les années de plomb en Algérie, une guerre plus barbare que civile qui a fait plus de 200 000 morts. Il y a des guerres qu’on commémore et il y a celles qu’on enterre encore plus profond que les victimes qu’elles ont faites. Un pays peut souffrir d’amnésie.
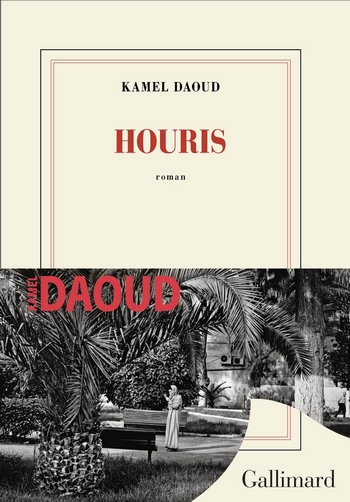 Une loi interdit depuis 2005 d’évoquer la décennie noire et rend l’oubli obligatoire. Mais Kamel Daoud n’est plus à une fatwa près. L’héroïne de son roman, qui s’appelle Aube, porte la marque indélébile sur sa gorge d’une nuit où, petite fille âgée de cinq ans, des djihadistes tentèrent de l’égorger. Sa cicatrice, sa canule et son souffle de voix rappellent à tous ceux qui la croisent les crimes impunis et ravivent les consciences intranquilles.
Une loi interdit depuis 2005 d’évoquer la décennie noire et rend l’oubli obligatoire. Mais Kamel Daoud n’est plus à une fatwa près. L’héroïne de son roman, qui s’appelle Aube, porte la marque indélébile sur sa gorge d’une nuit où, petite fille âgée de cinq ans, des djihadistes tentèrent de l’égorger. Sa cicatrice, sa canule et son souffle de voix rappellent à tous ceux qui la croisent les crimes impunis et ravivent les consciences intranquilles.
Prisonnière de son passé et de ses cordes si peu vocales, la première partie du récit est un monologue intérieur de cette jeune femme adressé au fœtus qu’elle porte. Elle lui raconte ses détresses, ses souvenirs, ses combats pour son indépendance face au pouvoir des hommes, son salon de coiffure qui hérisse les poils de barbe de la mosquée d’en face et elle va l’amener jusqu’à son village natal, à la recherche de ses fantômes.
Sur la route, elle croise un autre personnage, dont la folie va lui emprunter la narration pour quelques pages. L’homme associe à chaque chiffre, la date précise d’un massacre survenu pendant cette période. Un conte d’Ephéméride d’atrocités. Il garde la mémoire absolue des massacres, des lieux et des noms des victimes.
Il y a des livres qu’on a presque l’obligation d’adorer. Combat contre l’oubli, une puissance d’évocation absolue, un courage transgressif, une page d’histoire non massicotée, une langue poétique qui semble réservée aux exilés, un personnage inoubliable et pourtant…
Et pourtant, je suis resté à distance, presque à regret. A bien y réfléchir, je pense que le poids du symbole écrase le récit. L’intention de l’auteur effleure à chaque ligne, les atrocités relatées s’inspirent tellement de faits réels qu’il m’a été impossible de m’oublier dans le romanesque. Je n’ai pas réussi à traverser la Méditerranée. Et puis, cette absence totale d’humour, qui infecte même mon billet, n’offre aucun répit au lecteur. Ce roman manque d’aération, même si la violence des douleurs ne peut prêter à sourire. Impossible aussi de trouver aussitôt le sommeil. Difficile de compter les moutons qu’on égorge.
Hélas, une forte impression mais d’un point de vue littéraire, pas de Hip Hip Houris (il faut bien que j’en fasse une !) .
Ce livre, je l’ai plus admiré qu’adoré.
![]()
Olivier De Bouty
