Album du retour imprévisible du line-up original de Razorlight, Planet Nowhere est un drôle de plat très « light », presque diététique, au goût de madeleine proustienne, qui laissera sur leur faim ceux qui n’ont jamais apprécié la cuisine de Johnny Borrell & Co. Mais réjouira les autres…

Il y a six ans, le nom de Razorlight réapparaissait sur un album, plutôt correct d’ailleurs, Olympus Sleeping, suivi par une tournée en 2019, qui permettait de confirmer que Johnny Borrel restait un showman accompli, enthousiaste et talentueux. Sans émouvoir particulièrement les anciens fans d’un groupe qui avait connu une jolie popularité au début des années 2000 (America ? In The Morning ? Golden Touch ? Ces titres de singles à succès évoquent-ils quelque chose pour vous ?). Car cette incarnation-là de Razorlight n’était qu’un fantasme de Johnny Borrell, le leader du groupe, qui avait recruté une bande de musicos hétéroclites, pour un résultat plaisant mais qui n’avait pas grand chose à voir avec la musique de la formation originale. Cette fois, c’est différent, puisqu’on retrouve sur ce nouvel album (leur cinquième), l’intégralité du brillant line-up original de Razorlight : Björn Ågren à la guitare, Carl Dalemo à la basse et Andy Burrows à la batterie.
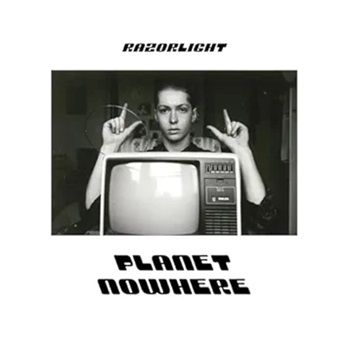 A propos de cette reformation improbable (tout du moins pour nous, en France, qui n’avons pas suivi le retour progressif des musiciens ces dernières années, alors qu’en Angleterre, le groupe a déjà tourné dans des salles de taille notable…), Johnny Borrell déclarait au NME : « C’était beau de revisiter ce que nous avions. Il y a toujours eu une dynamique électrique entre nous. J’avais cru que ce moment était passé. C’est un cliché de dire que nous nous sommes détendus, et je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais il y a eu des moments de vraie joie entre nous quatre. »
A propos de cette reformation improbable (tout du moins pour nous, en France, qui n’avons pas suivi le retour progressif des musiciens ces dernières années, alors qu’en Angleterre, le groupe a déjà tourné dans des salles de taille notable…), Johnny Borrell déclarait au NME : « C’était beau de revisiter ce que nous avions. Il y a toujours eu une dynamique électrique entre nous. J’avais cru que ce moment était passé. C’est un cliché de dire que nous nous sommes détendus, et je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais il y a eu des moments de vraie joie entre nous quatre. »
A l’écouter, ce Planet Nowhere pourrait être aussi bien le disque de la renaissance qu’un chant du cygne, un dernier coup de chapeau de Razorlight, un album à la saveur de madeleine de Proust (donc un peu rance, résultat des 16 ans qui ont passé depuis 2008, date du dernier album, Slipway Fires). Un disque de 30 minutes bien tassées fait entre potes, sans chercher particulièrement à séduire qui que ce soit d’autre. A moins d’un succès inattendu, bien sûr… Mais, soyons lucides, comme Johnny l’est clairement, qui va, en dehors de la Grande-Bretagne où il y a un bon contingent de fans nostalgiques, écouter, ou mieux encore, payer pour écouter ou voir sur scène Razorlight et leur musique… dépassée… même dans une version diététique, légère, ironique aussi, mais facile à digérer ?
Le titre d’ouverture, Zombie Love, peut servir de parfaite description de la demi-heure de musique qui nous est offerte : une chanson parfaitement idiote (ces paroles, mon dieu ! Mieux vaut ne pas trop s’attarder dessus…) posée sur une mélodie joyeusement addictive, que l’on prendra tous plaisir à reprendre : impossible de prétendre qu’on ne retrouve pas ici la magie des débuts du groupe, mais, comme on l’a dit, il y a une insouciance nouvelle, comme si rien de tout ça n’importait vraiment. Et il y a surtout une sorte d’allègement des orchestrations, que nous, fans de BD franco-belge, pouvons facilement assimiler à une approche « ligne claire » de la composition et de la production. L’inverse exact que ce que les groupes que nous détestons – de U2 à Coldplay – font : point de pathos, point de charge émotionnelle ici, juste une version dépouillée, squelettique du rock / pop. Pas si loin, si l’on veut – hérésie ? – de ce que faisait Jonathan Richman à sa grande époque…
U Can Call Me est un peu moins hors sol, avec un groove très US (soit l’une des marques de la musique de Razorlight, l’une des drôles de caractéristiques les distinguant du reste de la vague de Brit Pop dont ils firent partie). Taylor Swift = US Soft Propaganda est certainement le meilleur titre inventé par Borrell, même si la chanson est probablement trop courte avec ses deux minutes sautillantes et joliment absurdes pour lui rendre totalement justice. Dirty Luck est la première chanson un peu plus « sérieuse » de cette affaire : Borrell nous rappelle d’un coup qu’il est vraiment un chanteur convaincant. En plus Borrell s’amuse d’être le type qui « vend la drogue de son label », ce qui n’empêche pas la section rythmique d’être parfaitement convaincante. A ce stade, on a déjà bien compris que le groupe avait décidé de ne pas se prendre au sérieux, le paradoxe étant quand même que le crescendo final nous arrachera de petites larmes de joie.
Comme il y a vingt ans. Scared of Nothing est le genre de truc à la fois punky et joliment mélodique que les groupes de la « new wave » britannique composaient en dormant en 1979 : vous n’aimez pas ? Tant pis pour vous. Nous, on trouve ça parfaitement irrésistible : d’ailleurs Johnny a expliqué que c’est avec cette chanson que le nouveau / re-born Razorlight a retrouvé l’inspiration. « I got to make this puzzle fit / Yeah, I was born to do arithmetic / There’s no way I’ll prove the game is fixed / Well if it is then I’m still playing it » (Je dois terminer ce puzzle / Ouais, je suis né pour faire de l’arithmétique / Je ne pourrai jamais prouver que le jeu est truqué / Bon, si c’est le cas, j’y joue quand même !). Ça ne veut rien dire ? Réfléchissez-y, plutôt ! Et de toute façon, quelle conclusion de chanson !
FOBF est une autre jolie réussite, quelque part entre funk et glam rock, alors que Empire Service est un morceau assez insignifiant, que l’on préférera sauter, tant il est inutile. Cyclops ressemble à du Arcade Fire période Reflektor, sans la prise de tête caractéristique de Win Butler : comment ne pas s’en réjouir ? Cool People est la chanson la plus hilarante de l’album, qui prouve qu’à force d’être le sujet de moquerie, Johnny Borrell sait désormais comment mettre les rieurs de son côté : « There are no cool people, no cool people in this band ! » (Il n’y a pas de gens cool dans ce groupe). L’humour anglais dans ce qu’il a de meilleur : un véritable bijou, en fait, qui réhabilite d’un coup Razorlight comme un groupe vraiment… cool !
Le très beau April Ends est une conclusion impeccable à un album dont on hésite encore à dire qu’il est parfaitement génial ou légèrement ridicule : peut-être bien qu’on tient là un disque qui, comme les premiers Razorlight, nous tiendra éveillés / nous fera danser pendant des mois ? Ou peut-être ne s’agit-il qu’un feu de paille éphémère…
Mais est-ce que ça a vraiment de l’importance ?
![]()
Eric Debarnot
Razorlight – Planet Nowhere
Label : Razorlight Ltd. / V2 records
Date de parution : 25 octobre 2024
