La guerre Iran-Irak (1980-1988) occupe une place importante dans la fiction persane contemporaine. A travers la destinée tragique d’une famille, l’écrivaine iranienne raconte le traumatisme enfoui des civils, les séquelles visibles dans l’après-guerre ainsi que les ravages environnementaux dans la province meurtrie du Khouzistan, la plus touchée par les combats.

Le roman s’ouvre sur une image forte. Celle d’un père de famille, dont on nous dit qu’autrefois il fut grand et fort, désormais vouté et édenté, en train de rouler avec son jeune fils. Ils sont en route pour Dar-ot-Tale’e, un village insulaire dans les marais uniquement peuplé de femmes. C’est là que vit sa femme Naval depuis six ans, depuis qu’elle a abandonné le foyer conjugal, depuis que lui et ses trois enfants ne l’ont pas vue.
Le récit est presque construit comme un thriller, tant le mystère des raisons du départ de Naval imprègne toutes les pages, d’autant plus que Nasim Marashi retarde au maximum la rencontre avec cette arlésienne qui flotte au-dessus des lignes. L’histoire du couple est dévoilée par petites touches, très subtilement, sous forme de souvenirs jaillissant de la tête de Rassoul, de Naval, ou de moments du récit qui leurs sont connectés.
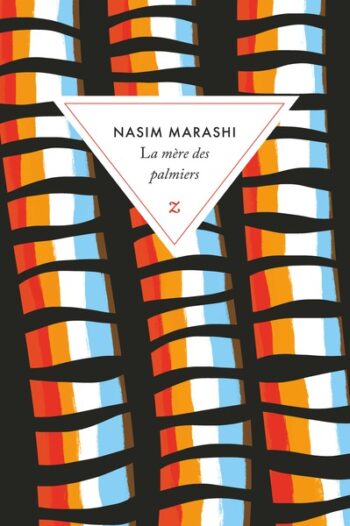
« Le pollen avait l’odeur du printemps dans la palmeraie de son oncle. L’odeur de la terre. Du Chatt al-Arab. Du soleil sur les vieilles feuilles de palmiers coupées. De la terre mouillée au soleil. Des bébés dattiers qui ressemblaient à des dattiers adultes en miniature et dont Naval était amoureuse, à qui elle donnait des noms et qu’elle préférait à ses poupées. Il avait l’odeur de ses cousins avec qui elle passait les jours fériés à courir dans la palmeraie, qui cueillaient en cachette des dattes hababouk, pas encore mûres, et les partageaient avec elle. L’odeur de son oncle, de son père. Le pollen avait l’odeur des hommes morts de sa vie. Des terres brûlées. »
L’intensité émotionnelle ne retombe jamais. Le contexte iranien apporte immédiatement de la profondeur hors-champ. Impossible d’oublier cette guerre d’Iran-Irak qui semble se prolonger avec la guerre du Golfe (1990-1991), la douleur de l’après-guerre quand il y a des morts à pleurer, des morts dont on ne se relève pas, des lieux qu’on a dû quitter et qui vous hantent à jamais dans l’exil.
La poésie de l’écriture de Nasim Marashi crée des images de toute beauté, notamment dans les scènes situées dans le village du Khouzistan où s’est réfugiée Naval, ravagé par les roquettes de l’armée irakienne : ses habitantes qui ne semblent plus qu’être dans la survie sororale, ses bufflonnes devenues stériles et ne donnant plus de lait, sa palmeraie brûlée … ce lieu vibre d’une aura magique presque surnaturelle qui aimante totalement le lecteur.
Presque une parabole d’où surgit, peut-être, un peu d’espoir lorsqu’au milieu du noir et du gris surgit un vert éclatant, celui des nouvelles pousses au pied des palmiers qui renaissent sous les soins d’une femme qui vient leur parler, les habiller, les dorloter comme s’ils étaient ses enfants.
Le récit soulève des émotions fortes, déchirantes, questionnant, au-delà de la dramatisation exacerbée liée à la guerre, la conjugalité, la maternité, la paternité, le deuil, la transmission, au plus intime de personnages qui paraissent souvent au bord de la folie. Pas de consolation facile pour eux, ni d’oubli rédempteur, mais tout de même la possibilité d’une résilience arrachée avec les dents au destin le plus sombre.
![]()
