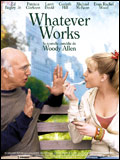 Nous ne faisons pas partie des spectateurs convaincus par les derniers longs-métrages de Woody Allen, considérant que son escapade européenne – Angleterre et Espagne – n’a rien ajouté à une carrière déjà bien remplie, dont il est de plus en plus avéré que les meilleurs moments sont désormais connus, ; le réalisateur de Manhattan au bout d’une bonne quarantaine de films ne parvenant plus guère à se renouveler, explorant jusqu’à en extraire le dernier jus, bavard et humoristique, ses sempiternelles obsessions que Big Apple, plus que toute autre métropole au monde, semble être la mieux placée à canaliser. C’est pourquoi faut-il se réjouir du retour au bercail de Woody Allen, qui exhume pour l’occasion un scénario vieux de trente ans, faute d’avoir trouvé l’interprète idéal – n’ayant pas à priori envisagé d’endosser le costume de Boris Yellnikoff, pourtant taillé sur mesure pour celui qui composa en 2006 le magicien cabot de Scoop.
Nous ne faisons pas partie des spectateurs convaincus par les derniers longs-métrages de Woody Allen, considérant que son escapade européenne – Angleterre et Espagne – n’a rien ajouté à une carrière déjà bien remplie, dont il est de plus en plus avéré que les meilleurs moments sont désormais connus, ; le réalisateur de Manhattan au bout d’une bonne quarantaine de films ne parvenant plus guère à se renouveler, explorant jusqu’à en extraire le dernier jus, bavard et humoristique, ses sempiternelles obsessions que Big Apple, plus que toute autre métropole au monde, semble être la mieux placée à canaliser. C’est pourquoi faut-il se réjouir du retour au bercail de Woody Allen, qui exhume pour l’occasion un scénario vieux de trente ans, faute d’avoir trouvé l’interprète idéal – n’ayant pas à priori envisagé d’endosser le costume de Boris Yellnikoff, pourtant taillé sur mesure pour celui qui composa en 2006 le magicien cabot de Scoop.
Boris est un vieux misanthrope qui a à peu près tout raté dans sa vie, : son mariage, son cursus professionnel qui ne lui permit jamais l’obtention rêvée du prix Nobel de physique, et pas davantage son suicide. Vivant seul dans un appartement miteux, il voit de temps à autre des copains bien indulgents à supporter d’éternelles récriminations. C’est dire si la rencontre fortuite avec Melody, jeune fugueuse provinciale, ne le réjouit pas d’emblée, d’autant plus que celle-ci s’installe à demeure. La suite est assez prévisible, émaillée de multiples rebondissements paraissant de plus en plus invraisemblables. Mais le réalisateur de Vicky Cristina Barcelona n’a pas l’air de se préoccuper de la grosseur des ficelles qu’il tire, ni du caractère extrêmement angélique, presque bêtifiant, des développements de son histoire. L’appartement de Boris se transforme petit à petit en une scène de théâtre sur laquelle surgissent, tels des diables échappés de leur boite, de nouveaux personnages dont le destin à leur tour va emprunter de nouveaux et inattendus chemins. C’est à l’apologie du hasard et des possibilités contenues dans toute rencontre, même initiée sous les pires auspices, que se livre Woody Allen. Dont Boris Yellnikoff est évidemment le double patenté. Ecrit en pleine force de l’âge, il est curieux de constater comment la vieillesse interpelle déjà le cinéaste, qui fait preuve ici d’un goût manifeste et jubilatoire pour l’autodérision et n’hésite pas à brocarder le milieu intellectuel et artistique, allant même lancer une petite pique à la France.
Plus que dans les opus européens, nous renouons avec la patte des dialogues à la Woody Allen, cinglants et percutants, à l’humour dévastateur. Peut-être émettrons-nous quelques réserves sur le dispositif mis en place, consistant à faire parler Larry David, comédien qui anime son propre show sur la chaine HBO et qui interprète Boris, face à la caméra. Loin des stars internationales des précédents films, les acteurs se révèlent pourtant à la hauteur, avec mention spéciale à Patricia Clarkson, campant une mère plutôt azimutée.
Alors que nous sentions poindre dans les derniers films une véritable mélancolie teintée de résignation, Whatever Works exhale au contraire un parfum d’optimisme et de gaieté. Constat en arrière-plan de l’Amérique actuelle, que Woody Allen fait mine de redécouvrir après son absence en attestant des changements survenus (élection d’Obama bien sûr), le film prône une énergie volontariste, exhortant chacun à saisir sa chance, à prendre son destin en mains, sauvant du coup l’ensemble des personnages réunis au final pour une sympathique photo de groupe, qui pourrait juste précéder la révérence finale.
La sortie de Whatever Works en été n’est sans doute pas innocente, tant cette comédie farfelue et légère, virevoltante et malicieuse, permet de passer un bon moment sans ennui ni déplaisir. Juste les esprits grincheux – dont on confesse faire partie – trouveront-ils dans la dernière livraison du réalisateur du Rêve de Cassandre beaucoup de redites et d’autocitations. Avec une prise de risques limitée et l’impression de retrouver un territoire, au sens large, très balisé. Résultat juste acceptable pour celui qui demeure, dans nos coeurs, comme un des plus grands cinéastes contemporains.
Patrick Braganti
![]()
Whatever Works
Film américain de Woody Allen
Genre : Comédie
Durée : 1h32
Sortie : 1er Juillet 2009
Avec Larry David, Evan Rachel Wood, Patricia Clarkson,…
La bande-annonce :

Un film usé et fatigué, mal joué mal éclairé,
basé sur une pseudo connivence avec le public (les acteurs s’adressent au public, quelle trouvaille !) des dialogues fielleux et sans originalité, des situations poussés à leur paroxysme (vous savez, comme dans « Au théâtre ce soir »). Bref le nouveau mauvais Woody Allen est sorti. Il doit avoir des choses à se faire pardonner (avoir épousé sa belle fille ?) pour en arriver là …